Journal
Compte-rendu : Triomphe ! Yakov Kreizberg et le Philharmonique de Monte Carlo
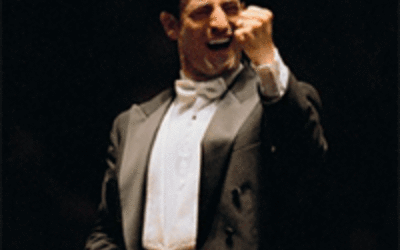
La salle et l’orchestre debout exigent le retour du chef. Il s’avance mais reste comme à l’abri de ses musiciens, ne veut pas saluer pour lui même. Cette leçon d’humilité dit beaucoup sur l’art de Yakov Kreizberg, d’abord au service des œuvres et aussi au service de l’Orchestre Philharmonique de Monte Carlo qui le lui rend bien.
En quelques concerts, les Monégasques ont ouvert leur sonorité, chacun s’est en quelque sorte révélé ; il en résulte une plénitude harmonique assez inouïe : on pouvait l’entendre saturer un Sacre du Printemps très russe, où les couleurs étaient jetées à baquets entiers. Sur cette matière fabuleuse, Kreizberg crée une tension constante ; il veut que tous soient toujours au maximum de leur engagement et il y parvient. Les plus infimes pianissimos portent, les fortissimos n’assènent pas des théories de sons morts mais viennent implacablement vous broyer dans votre fauteuil. « Quel orchestre !» entendait-on ça et là, murmuré dans le public. Là où tant dans le Sacre dirigent une fausse machinerie moderne, Kreizberg conte une histoire folle et tragique, d’un geste à la fois délié et péremptoire, incroyable de contrôle et de poésie (les Cercles mystérieux des adolescentes ! je n’avais jamais entendu leur inquiète vacuité à ce point dite). Bref il a tout compris d’une œuvre dont la simple mise en place colle les baguettes les plus virtuoses, trop préoccupées d’exactitude pour penser à la musique. Ici c’est tout le contraire : le sens musical affiné et fulgurant met tout en place avec une logique imparable. Admirable, transportant, on avait envie d’hurler à la fin de la première partie tant l’impact physique était à la limite du supportable : ce geste venait vous vriller l’âme et vous laissait le souffle court. Il rappelait rien moins que le geste terrible d’un Mravinsky.
Que Yakov Kreizberg soit un maître du répertoire russe, la cause est entendue depuis longtemps. Mais qu’il ait à ce point saisi l’esprit de finesse, les équilibres funambules, tout ce qui fait le vocabulaire de Maurice Ravel laisse pantois : le concert s’ouvrait par le ballet complet de Daphnis et Chloé, que l’on entend jamais. Le discours de Ravel, inféodé à la danse, s’y fait infiniment complexe, beaucoup s’y perdent et perdent avec eux leurs auditeurs.
Comment Kreizberg a-t-il trouvé, avec ce naturel déconcertant, le vrai tactus de l’œuvre ? On ne le connaissait dans l’absolu que par Monteux ou Ozawa. Les épisodes sont caractérisés avec un art de la narration transcendant, mais la ligne n’est jamais perdue, une main vous prend au premier accord et vous accompagne jusqu’à l’exultation dionysiaque de la Bacchanale : vous n’en perdez pas une miette. Le pas de deux de Daphnis et Chloé, modelé comme un duo d’opéra, avait pourtant un étonnant caractère de demi-mots, l’action de la danse innervait chaque tableau sans jamais défaire le discours poétique. Encore une fois, admirable, d’autant que l’orchestre est naturellement chez lui dans cette musique.
Tant de travail pour un seul concert laisse rêveur, il faudrait que Paris puisse entendre cela. Il paraît que des disques viendront pérenniser cette incroyable fête sonore ; on les attend avec impatience !
Jean-Charles Hoffelé
Monte Carlo, Auditorium Rainier III, le 28 mars 2010
> Vous souhaitez répondre à l’auteur de cet article ?
> Lire les autres articles de Jean-Charles Hoffelé
Photo : DR
Derniers articles
-
17 Décembre 2025Jean-Guillaume LEBRUN
-
17 Décembre 2025Laurent BURY
-
16 Décembre 2025Alain COCHARD







