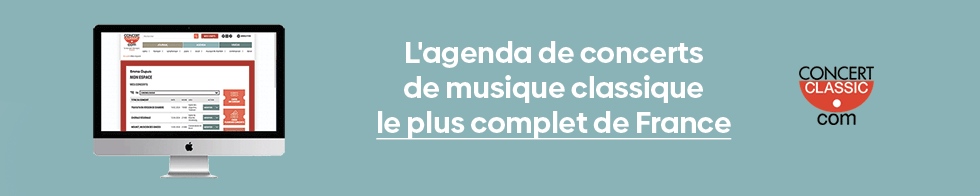Journal
Giselle revue par Akram Khan – La grâce et la tragédie – Compte-rendu

Juste avant Mayerling, de Kenneth Mac Millan, qui s’annonce prochainement au Palais Garnier, la série TranscenDanses des Productions Sarfati a pu offrir aux parisiens l’événement majeur de la saison chorégraphique. On avait déjà applaudi ici même, en juillet, et avec quel serrement de cœur, le départ scénique du grand Akram Khan (1), sorte d’icône à part de la danse contemporaine, pétri de multiples influences qu’il a su relier grâce à la force de sa personnalité. Voici enfin cette production vedette de Giselle, créée il y a six ans pour et par l’English National Ballet, qui a fait le tour du monde, et est venue à Paris provoquer un autre moment d’émotion, car outre sa tragique texture, elle était l’occasion des adieux à la scène de Tamara Rojo, directrice de la compagnie, qu’elle quitte à la fin de l’année pour le San Francisco Ballet. Fleurs en pluie, salle en délire, l’immense ballerine, insuffisamment vue en France, est pourtant l’une des touches majeures du clavier dansant contemporain.

© Laurent Liotardo
Merveilleux et bouleversant chemin vers le salut
Mais d’abord, le quatuor de stars : Rojo, donc, en Giselle, son Albrecht, Isaac Hernandez, danseur mexicain considéré comme l’un des meilleurs du monde, et couronné par le Benois de la Danse il y a quatre ans, Akram Khan, le séduisant ovni qui trouve le chemin de l’âme humaine en passant du kathak au chausson à pointes, et enfin Giselle, elle-même, sans doute l’héroïne la plus célébrée du ballet romantique, que chaque danseuse a rêvé d’incarner, même si elle n’en avait ni le physique ni le caractère. Car en Giselle se conjuguent l’alpha et l’oméga de l’amour : celui, terrestre, joyeux, frénétique d’une toute jeune fille qui en meurt, et celui, miraculeux, d’un esprit salvateur puisque le pardon lui permet d’arracher son séducteur insouciant au châtiment que lui réservent les fameuses willis, inflexibles vengeresses. Chausson planté dans le sol, fleurs dans les cheveux au 1er acte, puis chausson posé sur la scène comme une aile d’oiseau, emblème d’apesanteur au second, un merveilleux et bouleversant chemin vers le salut.
Désespérément noir
Le résultat est ici étrange, et parfaitement sinistre, car si la Giselle traditionnelle laisse habituellement sur une impression de tristesse délicate, celle que propose Akram Khan ne permet à aucune lumière de se glisser pour assainir l’ambiance et donner un zest d’espoir. Le chorégraphe est assurément l’un des meilleurs qui soient, par l’éloquence et la fluidité des gestes qu’il combine en une saga émotionnelle, aucun n’étant dépourvu de sens ou prétexte à performance. Le travail des bras coule en vagues, les corps flottent, et les sentiments affleurent dans chaque esquisse, comme des intonations dansées. Une merveille de composition et d’expressivité, mais dans le cas de cette Giselle, une tristesse lourde, qui jamais ne se dissipe, notamment parce que les savants éclairages de Mark Henderson, désespérément noirs, permettent à peine de discerner les visages, à plus forte raison lorsqu’ils sont voilés, comme ceux des willis . Et surtout, conçue par Vincenzo Lamagna, une masse sonore oppressante engendrée par les percussions et autres glas qui pilonnent l’action, avec de temps à autre, de légers rappels de la partition originale. D’où un climat d’étouffement, de contrainte psychologique, qui par ses excès nuit un peu à l’émotion de la danse, si belle.

Tamara Rojo © Jason Bell
Grâce mouvante
Quant à la teneur du récit, Akram Khan l’a transposé dans une société contemporaine, la paysanne devenant l’ouvrière, le seigneur devenant le patron, sur fond de monde en migration. Mais il n’a pas poussé la provocation à son terme, contrairement aux oppositions paroxystiques que sut faire remonter un Mats Ek dans sa géniale version de 1982, laquelle était restée fidèle à la musique d’Adam. Ici, le contraste réside plus dans la stylisation et l’esthétique, notamment des costumes magnifiques conçus pour la caste dominante (fabuleuses robes à paniers dessinées par Tim Yip pour des personnages figés dans leur statut de toute puissance) et la légèreté des tuniques qui nimbent les danseuses-ouvrières et accentuent leur grâce mouvante. Le tout sur fond de mur glacé qui sépare pauvres et riches, et se refermera finalement sur le désespoir et la solitude d’Albrecht, alors que la Giselle romantique offrait au moins la clarté d’une aurore avec sa cloche salvatrice…
Romantisme et foudroyante modernité
Mais on retient ces superbes parcours, dans une ambiance tragique à l’extrême, grâce à une interprétation au-delà de la perfection, car si Isaac Hernandez affirme sa beauté et sa vaillance sans faille, si Stina Quagebeur, immense Myrtha, impose une présence et des lignes marmoréennes plus qu’inquiétantes, Tamara Rojo, du haut de ses 48 ans, est tout simplement déchirante, frêle comme un roseau qui plie mais ne rompt pas. Dans son jeu autant que dans ses cambrés éplorés, on retrouve la vérité brûlée d’une Marcia Haydée, totalement habitée comme elle. Fabuleuse Rojo, aussi romantique que capable de la plus foudroyante modernité, pieds de rêve, qu’ils soient cambrés ou appuyés, et force inouïe de la grâce, lorsqu’elle reflète l’âme et non les manières. Son incandescence rayonne sur une compagnie en tout point remarquable, et elle aussi marquée par la passion.
Jacqueline Thuilleux

(1) www.concertclassic.com/article/xenos-dakram-khan-au-theatre-des-champs-elysees-lheure-des-adieux
Paris, Théâtre des Champs Elysées, 14 octobre 2022 // www.theatrechampselysees.fr/saison-2022-2023/danse-1/english-national-ballet
Photo : Stina Quagebeur, Tamara Rojo and James Streeter © Laurent Liotardo
Derniers articles
-
28 Juillet 2025Alain COCHARD
-
28 Juillet 2025Alain COCHARD
-
28 Juillet 2025Michel EGEA