Journal
Paris - Compte-rendu d'opéra : Une nouvelle Iphigénie pour Garnier
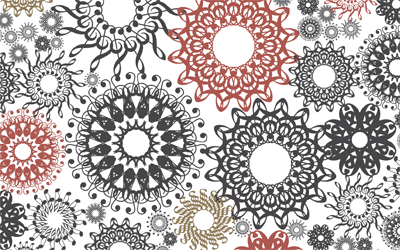
L’écran de scène qui, en lumière, reflète les ors et les pourpres de la salle prévient du projet de Warlikowski : mettre en abîme la non action d’Iphigénie en Tauride, cette histoire d’un sacrifice qui n’aura pas lieu et sera remplacé par un meurtre, celui de Thoas. Mais Warlikowski s’est encombré de niveaux de lectures qui s’interfèrent au point de créer un spectacle trop souvent brouillon : l’idée d’un drame parallèle qui se déroule dans une maison de retraite (avec douches et lavabos de caserne, éléments symboliques d’une esthétique qui commence à fatiguer le spectateur de Garnier comme de Bastille), et dont l’action n’est jamais sécante avec celle de l’opéra, ne sera qu’artificielle, et inutile jusque dans le partage du gâteau funéraire avec Iphigénie qui vient d’apprendre de la bouche de celui ci la fausse mort d’Oreste, moment qui fait assez justement enrager le public et provoque les protestations à la fin du II. Un ballet des Scythes, tourné en une farandole triste d’octogénaires, avec drapeau français en tête - vague allusion à la Terreur - avait déjà montré les limites malheureuses de ces tentatives de collage.
Warlikowski construit une autre parallèle, où les Atrides se retrouvent incarnés par une famille de la petite bourgeoisie, avec mariage au début. Celle ci est encore plus vaine que la précédente, sinon lorsque Oreste poursuivi par les Furies, revit son matricide : son double en jeune homme, campé par un fulgurant et touchant Antoine Bibiloni, se dépouille de ses vêtements pour accomplir le meurtre, lui donnant fatalement les gestes d’un inceste. La scène sera « revécue » lorsque Iphigénie s’apprêtera au sacrifice d’Oreste, sous la forme d’une projection des séances de répétition, et mêlée à d’autres images sur l’imminence de l’égorgement. Tout est là, Warlikowski a immergé la trame d’Iphigénie dans le passé sanglant des Atrides, il veut absolument provoquer des « ressurgissements », en plus même de ceux que souligne Nicolas-François Guillard. En cela il demeure particulièrement fidèle à la pièce d’Euripide et plus généralement à l’expression du fatum qui fait de tous les personnages de l’Orestie des aveugles dans les ténèbres. Et il faut concéder que ce qui dans ces dispositifs paraissait au I artificiel prend tout son sens à mesure que le drame se tend.
Warlikowski aime, comme Peter Sellars, utiliser le proscenium : la tragédie amoureuse entre Pylade et Oreste y gagne une dimension intime qui coupe le souffle : on n’y avait jamais perçu à ce point un homoérotisme aussi poignant jusque dans ses retenues. C’est que le travail du metteur en scène polonais respecte toujours la musique, fait assez rare de nos jours pour être souligné. On pourra objecter contre ce spectacle, mais on devra lui reconnaître une profondeur et une force rarement proposées cette saison parmi les nouvelles productions inspirées par Gérard Mortier, et l’on songe déjà au prochain défi de Warlikowski in loco, L’Affaire Makropoulos.
Dirigeant plus sombre qu’à l’accoutumée une partition qu’il a littéralement revisitée depuis 2000, Minkowski fait entrer toute la musique de Gluck dans ce spectacle surprenant : aucun hiatus ne se repère entre le son et l’image. En fosse, il imagine un univers hésitant idéalement entre tendresse et violence, faisant dire à l’orchestre autant qu’aux chanteurs : ces dictions des cordes, ces tirades de la petite harmonie, la plénitude des périodes, tout est pétri par un art du mot qui s’infuse jusqu’aux instruments. Et en scène c’est le règne absolu du verbe qui transcende ce spectacle et l’entraîne de l’opéra vers le théâtre, porté à bout de bras par un Yann Beuron mâle et sonore : dans l’éclat sombre de cette voix passe le souvenir du ténor ardent de George Thill, rien de moins. Russel Brown paraît plus frustre en Oreste, mais habite comme peu le versant sombre du personnage, moins sentimental qu’un Hampson ou qu’un Keenlyside, plus dangereux, plus fou, plus sexuel aussi, et la voix ample, très timbrée, possède une matière intense que les auditeurs ont pu ressentir lorsque Warlikowski lui demande de chanter dans la salle la reconnaissance d’Iphigénie (Dans cet objet touchant).
Franck Ferrari, qui pourtant n’oublie jamais d’exceller, a paru en petite forme dans l’air raréfié par la canicule qui enserrait Garnier. Le diapason semble le mettre mal à l’aise. Les parisiens ont encore une fois fêté Susan Graham. Français parfait, diction exemplaire, mais son Iphigénie, réfugiée derrière des pianissimos luxueux accompagnés par Minkowski jusque dans des vertiges flirtant avec le silence, manquait de noblesse blessée, peinait à trouver dans l’admirable prosodie gluckiste le profil grecque du personnage. Trop malheureuse Iphigénie, sans doute, un peu sentimentale par défaut, peu aidée par le très laid justaucorps dont Malgorzata Szczesniak l’engonce, qu’on aurait tort de bouder au fond, même si on rêve ici d’un timbre plus tranchant, d’un Falcon : Antonacci ? Il paraît que Maria Riccarda Wesseling, qui l’avait remplacé lors de la première, et que les parisiens pourront entendre pour les trois dernières du spectacle (les 4, 7 et 10 juillet) proposait une alternative autrement percutante.
Jean-Charles Hoffelé
Gluck, Iphigénie en Tauride, Palais Garnier le 18 juin, puis le 21, 23, 26, 28 juin et les 1er, 4, 7 et 10 juillet.
Achetez vos places pour le 7 juillet
Gluck en dvd
Photo : Eric Mahoudeau/Opéra de Paris
Derniers articles
-
17 Décembre 2025Jean-Guillaume LEBRUN
-
17 Décembre 2025Laurent BURY
-
16 Décembre 2025Alain COCHARD







