Journal
Bruxelles - Compte-rendu - Dans les secrets de l’ombre. Matthew Jocelyn signe une approche mesurée du chef d’œuvre de R. Strauss
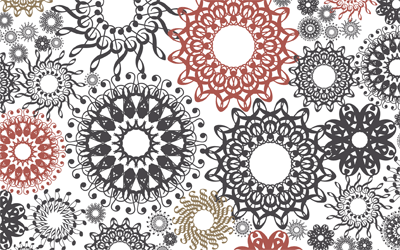
Pour cette nouvelle production, Matthew Jocelyn ne s’est pas encombré des poncifs orientalisant et de la poétique ombilicale qui nous ont fait tant de Frau ohne Schatten perdues dans les limbes pour mieux tomber dans le vérisme. Son « überwelt » stylisé, navigant à vue entre l’univers de l’Empereur, illustré par un polyptique à la flamande, montrant le regard terrifié par l’imminence de la pétrification, la gazelle tant poursuivie, l’aile rouge du faucon triste, et les monolithes de béton du palais de Keikobad, font mouche, comme la « factory » de Barak et de son épouse, passés de la condition de teinturier au statut d’artiste peintre post-Warholien.
Il y ajoute deux funambules figurant les esprits de l’Impératrice et de l’Empereur, voir Keikobad lui-même lorsqu’au III la Nourrice est aspirée par le feu inextinguible. Les nombreux changements de scènes occasionnent autant de recours au rideau, seul anicroche d’un spectacle efficace, mettant l’accent sur les destins des protagonistes, les débarrassant de l’armada symboliste et adoptant les coupures habituelles.
Aux cieux, une surprise divine, la plus belle Impératrice que l’on ait entendue depuis Rysanek (et l’on en a croisée, avec au sommet Ingrid Bjöner), Silvana Dussmann, à la colorature adamantine et puissante, aux registres dramatiques sans faille (la scène du renoncement final), qui trouve un partenaire de grand format en l’Empereur de Jon Villars, aigu de gloire, et expression blessée, perdue qui donnent la juste mesure d’un personnage trop souvent sacrifié sur l’autel de la futilité. A terre, le Barak sans arrières plans de Jean-Philippe Lafont, en bonne voix, met une santé réjouissante à son personnage, et il lui en faut pour supporter les assauts hurlés de sa mégère de femme. Gabriele Schnaut n’a jamais fait dans la dentelle, mais la Teinturière lui va au fond assez bien, et ses gourmandises de sexe, lorsqu’elle se trouve émoustillée par le jeune bellâtre, intelligemment projetées sur un écran, sont assez comiques.
C’est que Jocelyn a bien compris la subtile balance entre le trivial et le sublime qu’opèrent Hofmannsthal et Strauss, et les trois frères de Barak, en vrais noceurs bruxellois, le prouvent amplement. Pas de misérabilisme, pas d’ésotérisme, mais un conte philosophique plus léger qu’à l’habitude, on voudrait écrire moins allemand ? Oui, c’est cela. Le temps passe alors trop vite, l’orchestre emmené avec frénésie par Kazuchi Ono revendique sa place dans l’ouvrage, la première pour tout avouer, et conduit l’action dramatique avec une pugnacité qui n’a à envier à Böhm ou à Solti que quelques subtilités rêveuses trop gommées ici. L’orchestre immense de la Frau débordait de la fosse, les harpes, les célestas se faisaient face dans les loges, il enveloppait tout le théâtre de ses feux, mais n’absorbait jamais les voix, Ono respectant les pianissimo dont Strauss surcharge sa partition dés que le chanteur aborde des notes ou une phrase délicates. Bien vu décidément.
Mention spéciale pour la Nourrice de Michaela Schuster, rôle sacrifié en général, qui veut un grand mezzo et l’a eu cette fois ci. Bémol, si on ne nous avait pas annoncé que les costumes étaient signés Christian Lacroix, rien ne nous y aurait fait songer, et pourtant l’imaginaire de ce conte oriental aurait du déchaîner les folies et les sortilèges du couturier. Qu’est-il arrivé, mystère. Mais cela ne peut en rien ternir une production de premier ordre, qui rendait enfin accessible l’œuvre dans toutes ses arcanes.
Jean-Charles Hoffelé
Die Frau ohne Schatten de Richard Strauss, Théâtre de la Monnaie, Bruxelles, le 26 juin 2005, et le 29 juin.
Photo: Johan Jacobs





