Journal
Compte-rendu - Opéra Bastille - Willy Decker explore les mystères de La Ville morte
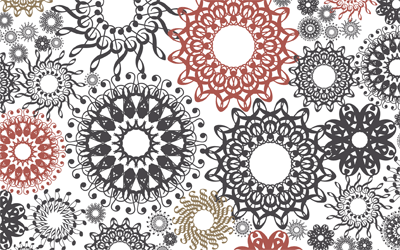
Présentée pour la première fois à Paris en mai 2001 au Théâtre du Châtelet, La Ville morte de Korngold (créée en 1920 à Munich et à Cologne et en 2001 à Strasbourg), avait fait beaucoup parler d'elle. Comment une oeuvre aussi puissante avait-elle pu être tenue si longtemps à l'écart des scènes françaises, alors que son intrigue fantasmagorique, sa musique foisonnante et ses personnages héroïques ont tout pour déchaîner l'enthousiasme ? La mise en scène surchargée d'Inga Levant n'avait pas totalement convaincue, ce qui explique qu'il fallut patienter encore huit ans pour voir enfin ce titre entrer au répertoire de l'Opéra National de Paris.
Nicolas Joel a choisi pour ce faire la production de Willy Decker, présentée en 2004 à Vienne et vue depuis à Salzbourg, Barcelone et San Francisco. Le spectacle est comme toujours avec ce metteur en scène, élégant, cohérent et lisible, ce qui n'était pas le cas du propos échevelé d'Inga Levant. Pour raconter l'histoire de Paul, hanté par le souvenir de son épouse défunte (Marie), qui vit cloîtré à Bruges, Decker joue avec l'espace et les perceptions, le rêve et la réalité, le dedans et le dehors. Le salon du héros se dédouble dès que celui-ci repense au passé (acte 1), ou se transforme à vue en théâtre (acte 2), murs, sols et plafond coulissant alors comme par magie, avant de reprendre leurs places comme si rien ne s'était passé (acte 3). Lorsque Paul rencontre la danseuse Marietta, il croit reconnaître en elle la disparue, mais refuse ses avances par fidélité envers celle qui fut son idéal. Marietta pense pouvoir le guérir de ses obsessions, mais après une nuit d'amour, elle constate son échec et entame une danse macabre avec les mèches de cheveux de la morte, religieusement conservées. Au comble de la rage, Paul l'étrangle avec ces boucles, avant de réaliser que tout ceci n'était qu'une hallucination.
Une mise en scène fluide, soignée dans les images qui viennent peupler le songe de Paul, comme cette procession ou ce théâtre de tréteaux improvisé, tenue dans son style chic et minimaliste, qui ne dessert à aucun moment cette histoire facilement compliquée, voilà qui n’est pas si fréquent. Si la direction d'acteur manque de précision et d'inventivité, le plateau est fort heureusement habité par deux fortes personnalités musicales : Robert Dean Smith et Ricarda Merbeth. Le premier possède l'endurance et le format de Paul, taillé dans le roc wagnérien et l'héroïsme straussien, avec un timbre coloré, un aigu conquérant et une réelle sensibilité.
La seconde, entendue à Toulouse dans Die Frau ohne Schatten (Die Kaïserin) et dans Le nozze di Figaro (où sa langueur monochrome avait lassé), est une révélation dans le double rôle de Marie/Marietta. Soeur de Salomé et de Lulu, par sa volupté et son ardeur vocales, son personnage tantôt aguicheur, tantôt ravageur, est à la fois d'une résistance absolue et d'une maîtrise souveraine. La voix libre et bien trempée flotte au-dessus de l'orchestre, inépuisable et glorieuse, s'épanouissant aussi bien dans le célèbre et délétère "Glück das mir verlieb" (acte 1), que dans la confrontation finale face à Paul. Si Angela Denoke fut la muse de Gérard Mortier, Ricarda Merbeth sera celle de Nicolas Joël.
Dans un allemand scrupuleux, Stéphane Degout compose un Frank guindé et un Fritz extraverti, subtilement différenciés vocalement, délivrant un magnifique "Mein Sehnen, mein Wähnen", archet à la corde. Doris Lamprecht (Brigitta), Alexander Kravets (Albert), Elisa Cenni (Juliette), Letitia Singleton (Lucienne), Alain Gabriel (Victorin) et Serge Luchini (Gaston) complétant cette homogène distribution.
Dans la fosse, Pinchas Steinberg, personnalité assez froide et rigide, ne traduit pas toujours avec la subtilité requise, la fantasmagorie propre à cette partition haletante. Née de la plume d’un jeune prodige d’un peu plus de vingt ans, l'orchestration qui évoque les richesses harmoniques de Strauss et le langage mahlérien, situe cet ouvrage dans la lignée du romantisme héroïque. Steinberg parfois gêné par des tempi et une métrique complexes, vient tout de même à bout d’une musique au symbolisme luxuriant, en la faisant couler de source et en la traitant comme une arche ininterrompue, soutenue par un orchestre déchaîné.
François Lesueur
E.W. Korngold : La Ville morte – Opéra Bastille, le 3, puis les 9, 13, 16, 19, 22, 24 & 27 octobre 2009
Programme détaillé de l’Opéra Bastille
Lire les autre articles de François Lesueur
Photo : Opéra national de Paris/ Bernd Uhlig





