Journal
Bruxelles - Compte-rendu - L’étoffe des ego. Le Songe d’une nuit d’été de Britten
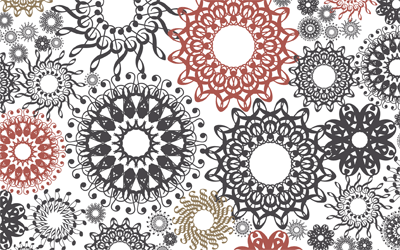
Pour ce Songe d’une nuit d’été, David McVicar joue une carte qu’on ne lui connaissait plus, celle de la modestie, à tel point que les spectateurs de La Monnaie qui n’auraient pas lu son nom sur l’affiche n’ont peut-être pas reconnu celui qui leur offrait un an plus tôt un génial et sulfureux Don Giovanni. Sa virtuosité est bien là, dans la tension sans répit du spectacle, dans la clarté d’un texte dont on savoure chaque mot, dans l’aisance “ chorégraphique ” avec laquelle il prend possession de la scène et de la salle, dans la présence lumineuse de chaque comédien, jusqu’aux petits elfes, mais elle se fait presque invisible, aussi discrète que la musique voulue par Britten pour le plus parfait des livrets.
A l’énigme “ qui rêve ? ”, boîte de Pandore pour les metteurs en scène “ à concept ”, McVicar, pragmatique, préfère se demander “ où peut-on faire un tel rêve ? ”. Nous voici dans un grenier inondé par la lumière entêtante d’une lune d’été à travers une charpente en ruine (l’image cite un plan du Edward aux mains d’argent de Tim Burton). Pas de forêt dans le décor de Rae Smith mais, autour de l’arbre qui a défoncé la charpente, des meubles XIXe et des jouets (habile “ glissement ” du cheval à bascule vers l’âne à bascule, de la tête d’âne de Bottom vers la b*** d’âne qu’il craint d’avoir perdu en reprenant sa forme humaine), tous ces “ pièges à souvenirs ” suscitant la douce déraison du rêveur pour un ballet de fées, d’amours contrariés et d’artistans/acteurs.
A l’onirisme esthétisant du spectacle aixois de Carsen s’oppose alors un théâtre virevoltant, dans lequel McVicar tisse minutieusement l’étoffe des rêves dont nous sommes faits (l’immense dentelle qui sert de rideau de scène a valeur de programme), et dont il compare l’enjeu initiatique à celui de Così - on n’est pas loin, non plus, des chassés-croisés des Noces, qu’il doit bientôt aborder à Covent Garden. Le charme nocturne de certaines scènes opère d’autant mieux qu’il s’inscrit dans un cadre parfaitement réglé, et la fin du II marque la supériorité d’une image intégrée dans le discours théâtral sur celles, fascinantes mais isolées, d’un Bob Wilson.
On pense en effet à sa fameuse reine de la nuit quand Obéron sort d’une trappe, vêtu d’une toge noire qui se déroule tandis qu’il s’élève à une dizaine de mètres du sol, à ceci près que McVicar ne laisse pas l’image se refermer sur elle-même, mais en fait le ressort de toute la fin de l’acte : Puck se déplace lui aussi loin du sol, sur d’immenses échasses (l’acrobate David Greeves, qui vole tel Peter Pan au-dessus de la fin du III) entre lesquelles les amants se cherchent… et l’on écarquille les yeux jusqu’au tomber de rideau comme un enfant au cirque.
Autre sujet d’extase pour la gente masculine, la silhouette de Laura Claycomb, Titania voilée de transparences qui, sur d’autres, seraient indécentes, et qui compensent, tout comme ses vocalises et ses contre-notes filées inouïes, le (relatif) manque de charme de son timbre, un rien métallique. Seul véritable écueil de la distribution, l’Obéron de Michael Chance, pauvre de ligne comme de nuances (rien au-dessus du mf… et pas grand-chose en dessous), manquant de charisme pour donner tout son relief au personnage ténébreux, parent du Quint du Tour d’écrou, voulu par Mc Vicar (“ Pour moi, une fée est un esprit écossais, plus proche d'un troll. Ce sont des créatures inquiétantes, parfois violentes, pas du tout bienveillantes. Je pense que c'est comme cela chez Shakespeare. Et Britten est toujours sensible à la bête noire qui se tapit sous la surface des choses ”).
On l’oublie vite, tout comme on ne fait guère attention à la direction prudente et avare en couleurs d’Ivor Bolton, pour admirer l’homogénéité vocale de la distribution et la performance d’acteurs : le quatuor d’amants a le physique de l’emploi et des timbres idéalement contrastés, le sextuor d’artisans (dont le magistral Bottom de Laurent Naouri) et l’aréopage d’elfes (Les Pastoureaux et le Trinity Boys Choir) n’appellent que des louanges.
Un triomphe annoncé, au moment duquel Bernard Foccroulle rendait publique sa volonté de ne pas aller jusqu’à la fin de son mandat, prévue pour juin 2009, et de quitter la direction de La Monnaie en juin 2007. C’est ce qu’on appelle le génie du timing.
Gaëtan Naulleau
Bruxelles, Théâtre de La Monnaie, le 11 décembre 2004. Jusqu’au 31 décembre.
Photo: Johan Jacobs
Derniers articles
-
04 Avril 2025Michel EGEA
-
31 Mars 2025Laurent BURY
-
30 Mars 2025






