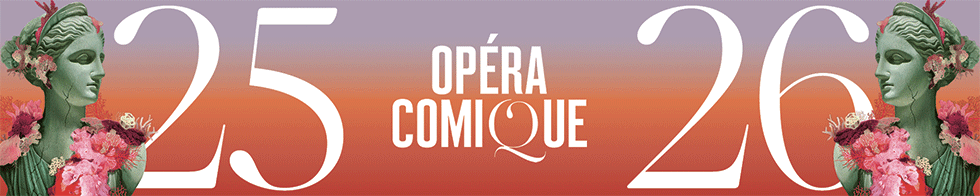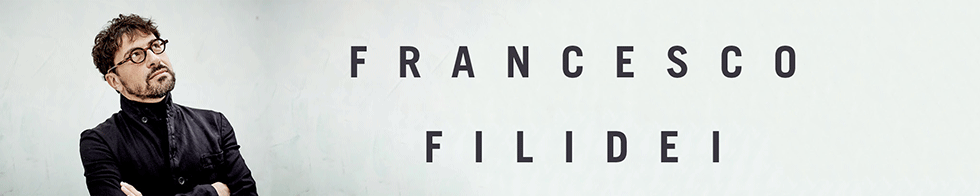Journal
Sigurd d’Ernest Reyer à l’Opéra de Marseille – Centenaire héroïque – Compte rendu

En 1919, le Grand Théâtre de Marseille était détruit par les flammes un après-midi de répétition de L’Africaine. Cinq ans plus tard, le 3 décembre 1924, c’est avec Sigurd du marseillais Reyer que le nouvel opéra art déco (classé au titre de monument historique depuis 1997) était inauguré. Pour commémorer cet événement, une nouvelle production de l’ouvrage constitue actuellement le point d’orgue de la programmation de la saison du centenaire ; elle est hélas étonnement boudée au soir de la première par un public qui, visiblement, n’apprécie pas les escapade hors des sentiers lyriques battus et rebattus. A tort !
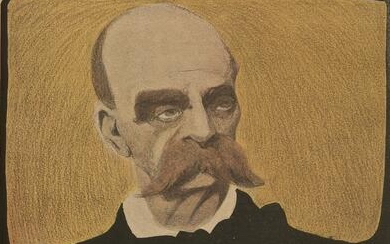
Du succès populaire à l’oubli
Il est né Louis Etienne Ernest Rey, le 1er décembre 1823, puis est devenu Reyer, à sa demande, par admiration pour le génie de Wagner. Concernant son Sigurd, une quelconque « wagnero dépendance » n’a pas lieu d’être évoquée puisqu’il achève la composition de l’ouvrage en 1867, presque une décennie donc avant la première représentation du Ring à Bayreuth (1876). Mais ce Sigurd, grand opéra à la française, bien loin d’être « la Tétralogie du pauvre » comme certains l’ont baptisé, aura la malchance d’émerger alors que que la France est en pleine « germanophobie » après la défaite de Sedan. D’ailleurs sa création aura lieu à Bruxelles, au théâtre de la Monnaie (1884) ; et le fait que Reyer déclare un jour à propos de Wagner et de son talent : « le génie du Titan victorieux écrase, anéantit… » ne facilitera pas les choses. Sigurd connaîtra toutefois un vrai succès populaire avant de quitter progressivement la scène et l’esprit des programmateurs, devenant selon eux « impossible à monter ».

Nicolas Cavallier (Hagen), Florian Laconi (Sigurd), Alexandre Duhamel (Gunther) & Marc Barrard (le prêtre d'Odin) © Christian Dresse
Puissance et romantisme
Comme une bulle à la surface lac de lave en fusion, la partition émerge désormais sporadiquement, le plus souvent en version concertante, avant de retrouver le magma. On peut le regretter car, comme écrit plus haut, ce grand opéra à la française est extrêmement bien composé, réunissant puissance et romantisme, certes avec quelques longueurs, mais surtout avec un soin de tous les instants pour réaliser une belle osmose entre la scène et la fosse. Les qualités de compositeur de Reyer, qui, on le sait peu, était de cousin de Louise Farrenc (1804-1875), sont indéniables.
S’il semble logique en raison du centenaire, le choix de proposer une nouvelle production de Sigurd (dernière représentation in loco en juin 1995), ne manque pas d’audace de la part de Maurice Xiberras, le directeur général de l’Opéra de Marseille, dans l’obligation de réunir un casting XXL pour affronter les difficultés de l’œuvre, de mobiliser les forces vives de la maison, orchestre et chœur, et de trouver les talents idoines pour assurer la direction musicale et signer la mise en scène.

Gunther (Alexandre Duhamel) et Gilen Goicoechea (un barde) © Christian Dresse
Charles Roubaud en terre d’élection
Concernant cette dernière, le choix s’est porté sur Charles Roubaud. L’enfant du pays est un habitué des œuvres monumentales et de leur traitement souvent spectaculaire. Avec Sigurd, il trouve un terrain d’expression idéal qu’il exploite avec retenue pour laisser toute sa place au jeu d’acteurs. Avec la décoratrice Emmanuelle Favre, il dispose de part et d’autre du plateau les monumentaux murs de granit gris et noir du burg du roi Gunther et se permet des changements à vue, entre certains tableaux, sans que la représentation en soit perturbée. Un environnement sombre et inquiétant pour installer une action librement inspirée des contes et légendes scandinaves et allemands. L’acte II, celui où Sigurd domine les Elfes, les Kobolds et autres Esprits avant de délivrer Brunehild des flammes entre lesquelles son père Odin l’a emprisonnée, est des plus réussis, les vidéos de Julien Soulier se substituant avec bonheur aux machineries et autres artifices qui, il y a cent ans, devaient procurer à « l’île sauvage » ( l’Islande ndr ) son ambiance surnaturelle. Des vidéos, dont use sans abuser Charles Roubaud, qui sont un vrai plus pour la scénographie et procurent de la cohérence à l’univers qui accueille les protagonistes vêtus dans l’esprit des Années folles par Katia Duflot.

Jean-Marie Zeitouni © Clayton Kennedy
Un chef pleinement investi
Dans la fosse, et dans les premières loges, l’orchestre au grand complet est aux ordres du Canadien Jean-Marie Zeitouni. Pour sa première marseillaise, le chef s’investit pleinement afin de mettre en lumière la qualité d’une partition qui, nous l’avons écrit plus haut, unit puissance épique et romantisme à l’instar d’une longue ouverture qui ne manque pas d’intérêt. Le maestro affectionne particulièrement le répertoire français et le prouve ici, livrant une lecture soignée de cette œuvre avec une attention de tous les instants portée aux voix. De-ci, de-là, il remet discrètement son monde dans le droit chemin sur le plateau lorsque c’est nécessaire et offre un terrain d’expression(s) majuscule à l’ensemble des pupitres qui en profitent avec assurance et sans restriction. Il convient aussi de souligner la performance du chœur de l’Opéra, lui aussi mobilisé en nombre, qui intervient tout au long de l’œuvre dans des formations à géométrie variable. La qualité de ses interventions, avec toutes les nuances voulues par la partition, est à la hauteur du travail préparatoire mené sous la direction de Florent Mayet.

Catherine Hunold (Brunehild) & Charlotte Bonnet (Hilda) © Christian Dresse
Une distribution 100% française
Sigurd a les traits et la voix d’un Florian Laconi (photo à g.)qui se dévoile ici en parfait heldentenor. Puissant et endurant il relève les défis imposés par le rôle avec, entre autres, une qualité de projection qui lui permet de passer sans problème le mur du son de l’orchestre. Il confère à son personnage, héros positif de l’œuvre, chevalier blanc au sens propre comme au figuré, toute sa vigueur, mais aussi sa sensibilité, notamment dans le duo d’amour de l’acte IV. C’est à Alexandre Duhamel (photo à dr.) qu’incombe d’incarner Gunther. Scéniquement, son jeu soigné procure sans aucun problème sa dimension royale au personnage ; vocalement, nous l’avons connu plus incisif et plus volumineux par le passé qu’au soir de cette première marseillaise où il est resté en demi-teinte entre les deux extrêmes de sa tessiture de baryton basse. Nicolas Cavalier n’a aucune peine à donner vie et voix à Hagen, un rôle noir qui lui convient parfaitement ; Marc Barrard fait valoir, lui, sa maîtrise vocale dans le rôle du prêtre d’Odin alors que Gilen Goicoechea a fait preuve de présence, de puissance et de sensibilité dans son interprétation fort appréciée du barde. Marc Larcher, Koëlig Boché, Jean-Marie Delpas et Jean-Vincent Blot, quatuor de huns, complétant la distribution du côté masculin.
Pour incarner Brunehild, Maurice Xiberras a fait appel à Catherine Hunold. Décision judicieuse, pour le moins, au terme d’une première où la soprano a livré avec puissance une interprétation limpide et acérée comme le tranchant de l’épée de son bien aimé. Belle présence scénique et vocale, aussi, pour la Hilda de Charlotte Bonnet qui fréquente ici un répertoire dont elle n’a pas (encore) l’habitude. Engagement dans le jeu, rigueur dans la voix : la soprano a séduit son monde et obtenu un beau succès. C’est Marion Lebègue qui incarne Uta, nourrice un peu sorcière, puisant avec assurance des accents tourmentés dans sa tessiture de mezzo-soprano.
Une distribution 100% française, venue conforter le directeur de l’Opéra de Marseille dans ses choix, et, pour beaucoup de spectateurs, la découverte dans les meilleures conditions d’une pièce lyrique aussi rare que séduisante.
Michel Egéa

> Les prochains concerts en PACA <
Ernest Reyer : Sigurd – Marseille, Opéra ; prochaines représentations les 6 & 8 avril 2025 // opera-odeon.marseille.fr
© Christian Dresse
Derniers articles
-
24 Avril 2025Michel ROUBINET
-
23 Avril 2025Alain COCHARD
-
23 Avril 2025Alain COCHARD