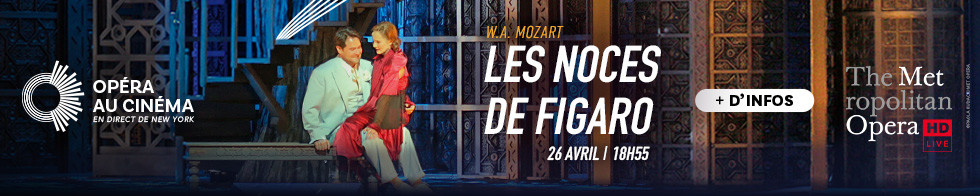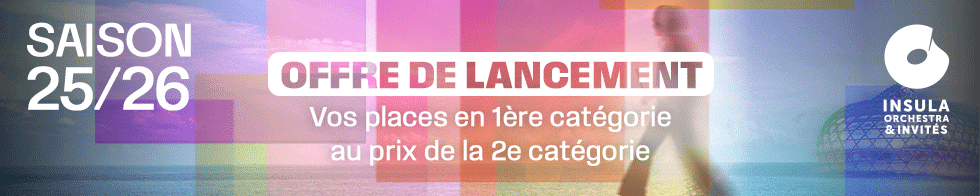Journal
L’Orchestre National de France et Cristian Măcelaru – Pour couronner l’année Saint-Saëns – Compte-rendu

Au cours du premier trimestre de la saison 2021-2022, l'Orchestre National de France et Cristian Măcelaru (photo) ont proposé, dès leur concert de rentrée du 10 septembre, le Concerto pour violon n°3, avec Daniel Lozakovich (1) ; puis les Concertos pour piano n°2 (30 septembre) et n°5 (7 octobre, également La Foi, trois Tableaux symphoniques op. 130), avec Alexandre Kantorow ; suivis d'un programme vocal avec Accentus (21 octobre) ; du Carnaval des animaux (4 novembre) ; des deux Concertos pour violoncelle, avec Sol Gabetta (26 novembre, 2) ; du Concerto pour piano n°4, avec Stephen Hough, l'ONF étant dirigé par Omer Meir Wellber (9 décembre). Le programme des 15 et 16 décembre associait, sous la bannière d'un thème commun, le Dies irae, un chef-d'œuvre de la musique symphonique française : la Symphonie n°3 « avec orgue » op. 78, et un non moindre chef-d'œuvre choral, si rarement entendu : le Requiem op. 54.
Ces concerts fêtent aussi la parution d'une intégrale (3) des cinq Symphonies de Saint-Saëns par l'ONF et Cristian Măcelaru (3 CD Warner), avec Olivier Latry à l'orgue Grenzing de l'Auditorium (ce que Warner semble avoir tout simplement oublié de mentionner, livret et boîtier), prolongeant ainsi une confrontation du National avec ces œuvres, en particulier la Troisième, richement documentée. Où l'on s'émerveille de voir le tout jeune Saint-Saëns maîtriser à ce point la forme et la matière : il a quinze ans quand il compose sa Symphonie en la majeur, nourrie de Haydn, Mozart et, dans le finale, Mendelssohn, d'une clarté toute rossinienne soudainement rehaussée, dans l'Andantino, d'impressionnants accents évoquant le théâtre de Gluck ou de Cherubini : un condensé, bluffant, de savoir orchestral. Il avait dix-huit, vingt-deux et vingt-quatre ans pour les suivantes (celles de 1850 et 1857 sont sans numéros). Quand à cinquante-et-un ans il compose sa dernière Symphonie, l'Opus 78 (1886), il est l'un des maîtres les plus inventifs de l'orchestre « moderne ».

La place de l'orgue dans la Troisième Symphonie de Saint-Saëns
Diverses reparutions récentes de versions discographiques historiques permettent d'élargir l'appréciation de la place quelque peu ambiguë de l'orgue : une couleur (bien que multiple) parmi celles de l'orchestre. Outre la nouvelle intégrale, Warner vient en effet de publier un coffret Saint-Saëns de 34 CD – dont les cires et rouleaux gravés par le maître en 1904, 1905 et 1919, toujours d'une confondante souplesse digitale ! Y figure une Troisième de 1954 : Ernest Bour dirige l'Orchestre du Théâtre des Champs-Élysées (en fait le National qui, sous contrat avec EMI, enregistrait ici pour Ducretet-Thomson, d'où le subterfuge). Maurice Duruflé joue l'orgue Mutin–Cavaillé-Coll de la Salle Gaveau, inauguré par Saint-Saëns en 1907, vendu en 1957 (seul le buffet, vide, est resté à Gaveau) et reconstruit par Gutschenritter dans la grande église de… Saint-Saëns (Seine-Maritime), région d'origine de la famille du musicien : si Camille vit le jour rue du Jardinet à Paris, entre boulevard Saint-Germain et rue Saint-André-des-Arts, son père était de Rouxmesnil, devant Dieppe, à quelques kilomètres de Saint-Saëns.
Outre une (pas tout à fait) « intégrale de l'œuvre pour orgue seul » par Daniel Roth (Isnard-Cavaillé-Coll de Pithiviers, 1978) proposée pour la première fois en CD, ce coffret reprend la première intégrale des Symphonies de Saint-Saëns par l'Orchestre National sous la direction de Jean Martinon (1972-1975), substituant néanmoins à la version d'origine de la Troisième (Bernard Gavoty à Saint-Louis-des-Invalides), celle, déjà avec Martinon et l'Orchestre National [de l'ORTF], avec Marie-Claire Alain à l'orgue de la Maison de la Radio (1970). Signalons que le vol. XXIII de la Discothèque idéale de Diapason consacré à Saint-Saëns s'ouvre sur la première version de Charles Munch (Carnegie Hall, 1947) ; que le coffret André Cluytens de Warner (65 CD, 2017) fait entendre l'Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire (qui donna la première audition française de l'Opus 78, en 1887), avec Henriette Puig-Roget à l'orgue du Palais de Chaillot : l'une des rares gravures de l'instrument, comme c'est d'ailleurs aussi le cas pour Gaveau en 1954 ; que la version Paul Paray / Marcel Dupré de 1957 à Detroit a été reprise par Mercury (et Diapason) ; que le même Paul Paray dirige l'Orchestre National [de l'ORTF] à Strasbourg en 1965, avec Pierre Cochereau à l'orgue du Palais des Fêtes (Solstice) – un finale délirant d'exaltation, immensément ovationné ; enfin que la toute première gravure de l'œuvre : 1930, Salle Pleyel, est accessible en ligne (voir discographie).
Soit autant de versions avec un orgue de salle, riches d'enseignement, pour un résultat sensiblement différent des versions « d'église ». Si lors des premières auditions du Grenzing de l'Auditorium (4), l'orgue n'était pas tout à fait terminé – Vincent Warnier était le soliste de la Troisième dirigée par Christoph Eschenbach –, songeons que l'œuvre fut créée au St James's Hall, alors principale salle londonienne (1858, détruite en 1905), qui disposait d'un orgue Gray and Davi[d]son de seulement dix-huit jeux sur un clavier et pédalier, avec pressions progressives, différentes pour fonds et anches. Instrument jugé insuffisant par les contemporains, mais dont Saint-Saëns (qui dirigeait la création) s'accommoda. Quelle est dès lors la place de l'orgue ? Force est de dire que les gravures de Pleyel, Carnegie Hall, Gaveau, Chaillot ou Strasbourg font entendre un orgue globalement très à l'arrière-plan (parfois même dans les ff de l'ultime section – ce que prise de son et emplacement de l'orgue peuvent aussi expliquer). Rien de tel à Radio France où Olivier Latry sut détailler, par des timbres efficacement projetés et intégrés au dialogue avec l'orchestre, tout ce que l'orgue fait dans le Poco adagio : bien plus qu'on ne l'imagine habituellement, et bien entendu dans le finale.
Tempos, éloquence et respiration – des approches contrastées
Des dizaines de versions de la Troisième ressortent très globalement deux grandes approches, avec d'un extrême à l'autre toutes les nuances imaginables. Munch ou Paray sont parmi les plus vifs et cinglants, Prêtre, Martinon et Măcelaru se positionnant sur l'autre versant. Si les minutages ne disent pas tout, du fait d'infinies variations au sein d'un même mouvement, certains parlent néanmoins. Munch 1947, d'une galvanisante âpreté (immédiat après-guerre – les cordes font penser à ses Honegger) : 31' 10", Măcelaru 2021 : 38' 04". La seconde partie du premier mouvement (Poco adagio) confirme la différence : 8' 53" pour Munch, 11' 29" pour Măcelaru. Ce dernier est, dans ce mouvement, d’une « lenteur » extraordinairement portée, magnifiant ligne et souffle de manière confondante, naturellement sans la moindre rupture de la phrase ou de la tension musicale. La lecture puissamment éloquente de Măcelaru exalte toutes les composantes d'un Orchestre National totalement investi, jamais la magnificence ne versant, aux dépens de l'esprit, dans une quelconque emphase, les inépuisables énergie et clarté de l'orchestre de Saint-Saëns animant chaque section de l'œuvre – ultime accelerando, avant la péroraison, à donner le frisson, pour un triomphe annoncé magnifiquement au rendez-vous.

Un chef-d'œuvre à (re)découvrir : le Requiem op. 54
Contemporaine de la création de Samson et Dalila, l'autre œuvre de ce programme, en première partie, fut pour beaucoup une révélation : Requiem op. 54 (1878) pour quatre solistes, chœur, grand orgue, orgue de chœur et orchestre (sans trompettes, clarinettes ou percussion), créé à Saint-Sulpice avec Widor en tribune. Le disque l'a infiniment moins servi que l'Opus 78. Ainsi le Requiem est-il absent du coffret Warner (+ ex-EMI Classics + Erato : aucune version aux catalogues de ces trois maisons réunies, c'est tout dire). Il en existe néanmoins deux très belles gravures, l'une plus incisive : Orchestre d'Orléans dirigé par Jean-Marc Cochereau, Maîtrise des Hauts-de Seine, Francis Bardot assurant lui-même l'importante partie de ténor, François-Henri Houbart à l'orgue de la Madeleine (+ pièces d'orgue, Solstice, 1991) ; l'autre plus élégiaque : Orchestre National d'Île-de-France dirigé par Jacques Mercier, Chœur Régional Vittoria d'Île-de-France dirigé par Michel Piquemal (+ Psaume XVIII, RCA / BMG, 1989 ; Sony, Jacques Mercier conducts French Masterworks, 10 CD, 2017 – dont de rares et généreux Saint-Saëns).
Animé par Judith Chaine, un avant-concert précédait la soirée du 15, au Foyer E de la Maison ronde, dont le mur du fond arbore une mosaïque de Gustave Singier : L'espace et la danse (1964). Martina Batič, cheffe principale invitée du Chœur de Radio France, y évoqua son travail sur le Requiem de Saint-Saëns et, de manière plus générale, la musique française. Un mot revint à maintes reprises, également utilisé par Cristian Măcelaru dans son entretien avec Christian Wasselin : intimité. Tout en ressentant parfaitement l'idée durant le concert, l'impression générale fut néanmoins, comme pour la Symphonie, celle d'un déploiement orchestral et vocal particulièrement saisissant, l'intimité pouvant dès lors principalement relever d'une soumission drastique au style et à l'éthique de cette œuvre formidablement concise, aucun des solistes – Véronique Gens (soprano), Aliénor Feix (mezzo-soprano), Julien Behr (ténor), Nicolas Testé (basse) –, membre du Chœur (réparti, pour des questions de protocole sanitaire, sur tout l'arrière et les côtés du premier balcon : phénoménale image sonore en cinémascope) ou instrumentiste ne pouvant tirer à soi la couverture. L'œuvre, admirable, inventive et à tant d'égards audacieuse, exige force et modestie : Saint-Saëns remerciait, en toute liberté, un défunt mécène de lui avoir permis de s'affranchir des contraintes du métier d'organiste d'église. Et c'est toute la musique de cette œuvre saisissante qui se ressent de cet affranchissement.
Pour retoucher terre après ces Opus 54 et 78, l'ONF et Cristian Măcelaru offrirent en bis le moment de pure détente, mais concentrée devant tant de charme et de surprises au gré d'une structure aux éclairages mouvants, dont le public avait besoin : Adagio de la Symphonie n°2 op. 55 (1859). Saint-Saëns, bien au-delà de l'année du centenaire, n'a pas fini de nous séduire et de guider nos sensibilités elles aussi affranchies de tout conformisme d'écoute. Chacun pourra s'en convaincre en revivant à volonté ce concert du 15 décembre.
Michel Roubinet

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/musique-chorale/saint-saens-ndeg-3-avec-orgue/concert-de-noel
Filmé par Camera Lucida Productions, dans une réalisation de François-René Martin, la soirée est proposée sur Arte Concert jusqu'au 14 décembre 2024
www.arte.tv/fr/videos/106742-000-A/grand-concert-symphonique-camille-saint-saens/
(1) Concert disponible sur le site de France Musique
www.francemusique.fr/concert/maison-de-la-radio-et-de-la-musique-auditorium-messiaen-saint-saens-boulez-ravel-lozakovich-onf-macelaru
(2) Concert donné à la Philharmonie de Paris, disponible sur Arte Concert jusqu'au 25 novembre 2025
www.arte.tv/fr/videos/104533-004-A/cristian-macelaru-dirige-saint-saens-faure-et-scriabine/
(3) À propos de Saint-Saëns : Un entretien avec le directeur musical de l’Orchestre National de France, par Christian Wasselin
www.maisondelaradioetdelamusique.fr/article/cristian-macelaru-le-national-et-le-son-francais
(4) www.concertclassic.com/article/premieres-auditions-de-lorgue-grenzing-de-radio-france-en-attendant-lharmonisation-complete
Photo © Sorin Popa
Derniers articles
-
17 Avril 2025Michel EGEA
-
17 Avril 2025François LESUEUR
-
17 Avril 2025Laurent BURY