Journal
Paris - Compte-rendu : Une nouvelle chance pour Luisa Miller ?
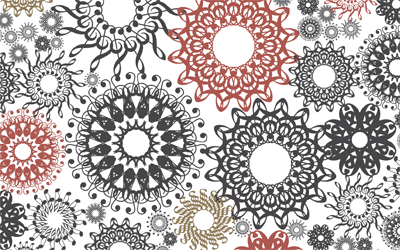
Donner une nouvelle chance à Luisa Miller supposait de la part de l’Opéra de Paris un tout autre investissement artistique, du moins pour la régie. Car s’il y a un opéra de Verdi qui appelle une certaine transgression de la tradition, c’est bien cette histoire déduite par Cammarano du Kabale und Liebe de Schiller. Sa trame dramatique bouleverse les rapports classiques entre les personnages autant que leur nature – un seul exemple, le vieux Miller est autant un père qu’une mère - et se solde par l’empoisonnement de l’héroïne de la main même de son bien aimé. La noirceur du sujet appelait un tout autre dispositif scénique que la tiède carte postale proposée par le décor et les costumes, pratiques et qu’on espère peu coûteux, de William Orlandi. On se croirait revenu au bon vieux temps du répertoire de décor, celui-ci pourra aussi servir à Guillaume Tell. Sur un dispositif aussi morne, Gilbert Deflo n’offre qu’un pur spectacle illustratif, une convention, sans un gramme de direction d’acteur.
On ne croyait pas possible de revenir d’un coup si total à tous les poncifs de l’opéra et l’on peine à croire que cette production aura pu voir le jour sous l’œil sourcilleux et visionnaire de Gérard Mortier. D’autant qu’il en a soigné la distribution, offrant à cette œuvre délicate un cast subtilement apparié : commencés petits et un rien contrits la Luisa d’Ana Maria Martinez et le Rodolfo de Ramon Vargas vont trouver à mesure que le spectacle se déroule l’exact calibre vocal de leurs emplois, plus héroïques, plus expressifs, avec au III une violence contenue, un désespoir sans remède assez magnifiquement rendus.
Oui, mais voilà, les formats vocaux des chanteurs ne sont en rien adaptés aux gigantesques volumes de Bastille, et la distribution aurait répandu plus de feux à Garnier, jusque dans son optique belcantiste assez juste. Il y a dans Luisa Miller des réminiscences de Lucia di Lammermoor, de Sonnambula et même des Puritani que les stylistes réunis ici soulignaient à loisir et avec raison.
Dobber était au fond un Miller assez idéal, avec son timbre naturellement vieilli, Kwangchul Youn comme d’habitude un modèle de beau chant pour un Wurm presque trop noble, le soprano adamantin d’Elisa Cenni faisait briller les quelques notes de Laura d’une tristesse prégnante. Deux acteurs naturels passaient outre la morne régie de Gilbert Deflo, Idar Abdrazakov, Conte di Walter féroce, grand baryton Verdi au chant admirablement sculpté, mordant dans les mots jusqu’à sacrifier un rien la ligne (on rêve déjà de son Conte di Luna) et Maria José Montiel, en voix superbe, créant en quelques gestes une Duchessa d’Ostheim émouvante et trouble à la fois.
En fosse Massimo Zanetti dirigeait pour le seul décor : sans tempo, sans accent, sans tension, égalisant tout, surveillant le plateau pour lui refuser la moindre goutte d’inspiration. Décidément, les chanteurs étaient bien seuls.
Jean-Charles Hoffelé
Giuseppe Verdi, Luisa Miller, Opéra Bastille le 23 février, puis les 26, 29 février et les 2, 5, 8 et 12 mars 2008
Réservez vos places à l’Opéra de Paris
Photo : Franck Ferville
Derniers articles
-
17 Avril 2025Michel EGEA
-
17 Avril 2025François LESUEUR
-
17 Avril 2025Laurent BURY







