Journal
Toulouse - Compte-rendu : Opus majeur
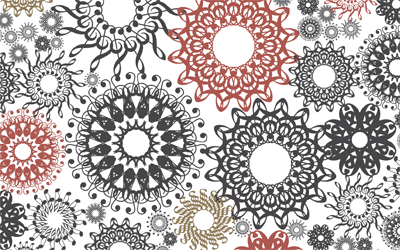
Le Capitole reprend son Trittico.
On fait toujours un mauvais sort au Trittico en en séparant les trois volets, pratique commune depuis que son finale comico, Gianni Schicchi, a pris son envol. Pourtant, aussi brillant, aussi habilement troussé, aussi efficace que soit le petit tour de force que Dante inspira à Puccini, Il Tabarro et SuorAngelica se révèlent des partitions plus marquantes, usant avec art consommé du détournement : celui du vérisme pour le premier, celui du mélodrame pour le second. Nicolas Joël et Stéphane Roche ont tenu à traiter les trois partitions dans une même ligne réaliste qui ne cherche pas midi à quatorze heure : elle laisse au génie particulier des chanteurs qui le veulent bien toutes les marges pour y infuser leurs visions de personnages d’autant plus saillants que leurs rôles sont brefs.
Et là encore l’esprit maison s’entend habillement à composer des distributions qui frôlent la perfection. Deux exceptions pourtant : Doïna Dimitriu sera probablement une Turandot percutante, mais pour la Giorgetta du Tabarro, il faut plus de fièvre, plus d’angoisse, plus de désir et un peu moins de cette santé qui vibrionne des aigus coruscants. Et pour la terrible Principessa de Suor Angelica, Mariana Lipovsek, actrice aussi économe que terrifiante ne parvient pas à donner le change à une voix épuisée, même par le très habile numéro de grande sociétaire qu’elle y déploie.
Ailleurs que du bonheur : Juan Pons dont une seule note nous met dans l’oreille la voix exacte de Falstaff réussit un Michele d’une sobriété étonnante, et l’on se doute que pour Schicchi, des moyens aussi somptueux permettent une composition de haute volée, sans aucun histrionisme, où le personnage prend une vérité assez loin de la simple comédie : c’est un père qui sauve le bonheur de sa fille, tout simplement, et met en place pour y parvenir une mécanique parfaite dont la vis comica n’est pas la finalité mais un simple effet induit. En Lauretta, Anne-Catherine Gillet dernière étoile révélée par le Captiole, époustouflait par le naturel, la flamme, l’accent juvénile qui emportaient son « O mio babbino caro » loin des pâmoisons sentimentales qu’on y entend trop souvent. Pourtant, tous avaient le souvenir de la Lauretta miellée de Vaduva, héroïne des premières représentations de cette production en 1997, mais le surcroît de fraîcheur apportée par la soprano belge lui donnait la primauté.
Son Rinuccio révélait un jeune ténor espagnol de grande venue : aigus dardés, voix placée très haut, ligne solaire, phonation parfaite, il faudra surveiller Ismael Jordi. Il sera le Ferrando de Donna Francisquita in loco la saison prochaine, et le Châtelet lui offre Vincent dans son futur revival du Chanteur de Mexico. La troupe de chant était immaculée, dominée par Riccardo Cassinelli, vétéran qui n’avoue plus son âge mais fait les jeunes hommes en osant des jeux de scène incroyables : sa chute dans l’escalier de Schicchi (avec sa gerbe de dents qui s’échappent, irrésistible !), l’habile composition de fatigue et de désespoir déguisée en fausse joie par le vin qui nous donne le plus tangible des Tinca sont plus que des compositions, de vrais moments de théâtre. Et la voix, toujours aussi corsée, ne montre pas une once de fatigue. Mais tous seraient à citer, et surtout Cinzia di Mola, Mère supérieure assez terrifiante (on l’imagine bien en Principessa) et Zita acariâtre. Pour le Luigi du Tabarro, Nicola Rossi Giordano manquait un rien d’héroïsme dans l’aigu mais sa composition subtile palliait cela. Tous attendaient la Suor Angelica de Tamar Iveri : sans aucun maniérisme, avec à peu prés la voix du bon Dieu, la soprano géorgienne donnait à cette femme brisée par la cruauté de sa famille une puissance, une intensité dramatique qui pourtant ne sollicitaient jamais un texte restitué avec une fidélité rare.
Le bonheur le plus révélateur venait en fait de la fosse : Marco Armiliato, qui avait su trouver la saison dernière le tactus exact et l’esprit si subtil de la délicate Rondine, révélait à quel point l’orchestre de Puccini est moderne : ses bizarreries expressives visionnaires (tout le Tabarro compte parmi ce que le compositeur a écrit de plus pertinent et de plus surprenant à la fois), ses raffinements où la tonalité est poussée dans ses ultimes retranchements (Suor Angelica), sa suractivité proche de la folie (comment l’instrumentation fourmille autant que les voix dans Schicchi) ont trouvé dans les musiciens du Capitole autant de médiums inspirés.
Jean-Charles Hoffelé
Giacomo Puccini : Il Trittico , Théâtre du Capitole, Toulouse, le 12 mai.
Photo : Patrice Nin
Derniers articles
-
17 Avril 2025Michel EGEA
-
17 Avril 2025François LESUEUR
-
17 Avril 2025Laurent BURY







