Journal
Paris - Compte-rendu : L’Amour des trois oranges selon Gilbert Deflo. Pour les enfants.
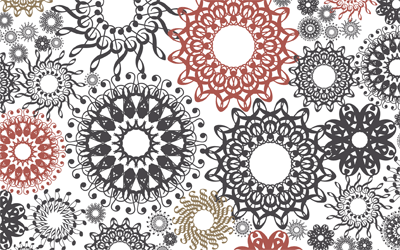
Gérard Mortier a voulu pour le spectacle de fin d’année de l’Opéra de Paris faire un joli cadeau aux têtes blondes : nul doute que les enfants seront sensibles à cet Amour des trois oranges où Gilbert Deflo, compagnon de route de Mortier durant les belles années de La Monnaie, infuse dans la fantaisie de Gozzi une bonne pinte de cirque et une autre, plus naturelle à l’ouvrage, de Commedia dell’Arte.
Mais pour que prenne cette mayonnaise aventureuse et un peu approximative un ingrédient manque : l’humour. En général, on rit beaucoup à L’Amour des trois oranges, conte désopilant par essence, et parfois même l’ouvrage peut autoriser des mises en scène totalement bouffonnes qui font mouche (comme celle proposée cette saison par l’Opéra de Sydney) ; or on ne riait guère devant le travail de Gilbert Deflo. Défaut rédhibitoire dans un opéra dont le sujet est la salvation par le rire, justement. La faute probablement au décalage entre ses intentions et la réalisation musicale. Un orchestre tombé dans la fosse d’orchestre la plus profonde qu’ait jamais offerte Bastille s’interdit toute communication avec le plateau, premier hiatus terrible, le second résidant dans la direction éteinte de Sylvain Cambreling.
On ne peut pas produire dans cet opéra flamboyant une grisaille si terriblement déprimée, c’est au moins péché mortel, il faut que tout pétille, que tout s’ébroue dans cette partition où Prokofiev semble relever à chaque page le défi de Cocteau : « Etonnez moi !». Pour ceux qui ont encore la course folle et la virtuosité incandescente qu’y mettait cet été à Aix Tugan Sokhiev le contraste aura été terrible. Cambreling communique si peu avec la scène que les chœurs multiplient les décalages et les entrées approximatives. Mais la distribution excelle souvent : Charles Workman, ténor décidément génial au français impeccable, à la projection claironnante qui ne sacrifie jamais la ligne expressive donne du Prince une interprétation inédite, bien plus sombre qu’à l’habitude, prisonnier de son costume de Pierrot dépressif, le Truffaldino éclatant de Barry Banks tient ses promesses, véritable maître du jeu, et pour une fois distribuée dans un emploi vocal qui correspond à ses réels moyens Beatrice Uria Monzon fait une sulfureuse magicienne.
Une fois chauffé le Roi de Philippe Rouillon égalerait presque le souvenir laissé par celui de Gabriel Bacquier, Jean-Sébastien Bou met son énergie funambulesque à un étonnant Farfarello sortit tout droit d’une équipée de vampires, Ballestra impeccable en Pantalon, Zamàskaya touchante, fragile Ninette, Lucia Cirillo, Sméraldine plus ambigue que ne le laisse transparaître son maquillage de négresse. La cuisinière tombe naturellement dans les cordes bouffes de Victor van Halem. Il n’est pas certains que l’idée de Deflo - l’avoir transformée en géant du nord et affublée d’un couteau classique plutôt que la terrible louche- soit gagnante : cela fige le personnage et rend ses poursuites de Trouffaldino assez vaines. On ne peut ôter de notre mémoire Jules Bastin dans la mise en scène de Louis Erlo à Lyon, toujours inégalé.
Hélas, José van Dam est dans sa plus mauvaise tessiture pour Tchélio, et son incarnation générique laisse dubitatif, tout comme le Léandre en voix de bois de Guillaume Antoine et la Princesse Clarice sans vrai caractère d’Hannah Esther Minutillo, soprano décidément anonyme mais au physique avantageux. Un conseil, emmenez vos enfants, le spectacle devrait les ravir et leur ouvrir la porte du monde magique de l’opéra.
Jean-Charles Hoffelé
Première de L’Amour des trois oranges de Serge Prokofiev, La Bastille, le 1er décembre 2005, puis les 5, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 26 et 29 décembre.
Photo : Eric Mahoudeau/Opéra national de Paris
Derniers articles
-
17 Avril 2025Michel EGEA
-
17 Avril 2025François LESUEUR
-
17 Avril 2025Laurent BURY







