Journal
Compte-rendu - Festival Agora - Les incertitudes de la création
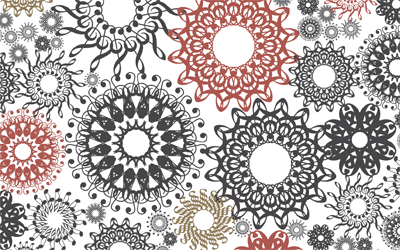
La création est et doit rester une aventure. Pour sa douzième édition, le festival Agora s’était d’ailleurs choisi pour thème une belle métaphore de cette aventure : les « sentiers qui bifurquent ».
Il y a dans cette notion de sentier l’idée d’un parcours déjà en partie accompli, d’un passé de la musique contemporaine qui était cette année célébré sous la forme d’un hommage à Luciano Berio, qui fut le premier directeur de la section électroacoustique de l’Ircam. Les trois œuvres programmées – dont aucune n’utilise l’électronique ni l’informatique – sont autant de dérivations des schémas traditionnels. Passagio (1962), donné par l’Ensemble intercontemporain lors du concert d’ouverture, est une violente charge, que l’on peut dire toujours actuelle, contre l’ordre établi (représenté par le chœur – admirable Capella Amsterdam – qui barre l’espace scénique) et contre son complice, le peuple, le public imité dans ses réactions par un « chœur parlé » (le Jeune Chœur de Paris) dispersé dans la salle. La direction de Susanna Mälkki, très uniformément sombre, faisait ressortir la tension dramatique portée par la soliste – Julia Henning, parfaite dans son rôle de victime innocente que le monde, la société établie veut réduire au silence. Ce faisant, elle gommait tout le côté « bouffon » de l’œuvre dont l’interprétation de David Robertson, avec les mêmes musiciens en 1993, avait laissé le souvenir.
Quelques jours plus tard, Coro (1976), chef-d’œuvre choral du compositeur, fut la plus grande réussite de cet hommage, sous la direction experte de Michel Tabachnik, portant avec une remarquable ferveur épique les quarante voix du Chœur de la radio flamande, disséminée au sein de l’orchestre (l’excellent Brussels Philharmonic), une heure durant, au long des trente et une séquences de l’œuvre. Enfin, Formazioni (1987) joue sur la disposition des instrumentistes sur scène, bouscule les équilibres de l’orchestre symphonique habituel et met ainsi en cause les rapports harmoniques entre les groupes d’instruments. La direction excessivement tendue de Jean Deroyer à la tête de l’Orchestre de Paris n’a cependant pas permis de provoquer toutes les « circulations sonores » auxquelles prête l’œuvre.
Trois créations étaient mises en regard des œuvres de Berio. Trois Manifestes de Luis Fernando Rizo-Salom, compositeur colombien né en 1971, et Sirènes de Luca Francesconi (né en 1956), ancien élève de Berio, reprennent l’idée d’une dispersion des interprètes (groupes instrumentaux pour le premier, chœurs pour le second) au sein du public. Les deux œuvres jouent de l’accumulation sonore – poussant le fortissimo jusqu’à l’abolition des résonances chez Rizo-Salom – mais peinent à totalement convaincre par leur pesanteur. Ce n’est pas le cas du Livre des illusions de Bruno Mantovani, d’orchestration plutôt brillante, qu’interprétait l’Orchestre de Paris. Évocation musicale d’une expérience gastronomique, l’œuvre vaut mieux que son propos anecdotique mis en avant par des extraits choisis précédant a création. Mais les trente-cinq « mouvements », correspondants à autant de plats, ont tendance à se répéter et l’utilisation de l’informatique relève plus de la petite cuisine que de l’illusion sonore annoncée.
Des « sentiers qui bifurquent », certains auront tourné bien court. C’est le cas de l’opéra d’Hèctor Parra, empêtré dans un livret impossible, qui ne parvient pas à choisir entre la radicalité d’un exposé scientifique et une intrigue amoureuse tout à fait conventionnelle – la mise en scène se refusant, d’ailleurs, à traiter l’un ou l’autre. C’est dommage, car durant les quelques minutes où l’Ensemble intercontemporain jouait seul, sans avoir à soutenir le plat débit vocal, la musique du jeune compositeur catalan (né en 1976) semblait plutôt intéressante, foisonnante et dynamique.
Si, dans l’ensemble, les créations interdisciplinaires et multimédia ont déçu (comme l’intervention du chorégraphe Alban Richard avec le compositeur Paul Clift ou la partition électronique de Mauro Lanza pour le film La Sorcellerie à travers les âges), on retiendra le nom du New-yorkais Aaron Einbond (né en 1978), qui montre dans What the blind see, interprété par l’ensemble L’Instant donné au 104, quelques-unes des possibilités actuelles de l’électronique musicale, qui ne serait plus le simple prolongement de l’activité instrumentale.
Il fallait cependant être patient et attendre la dernière soirée pour découvrir les chefs-d’œuvre de cette édition d’Agora. Avec Operspective Hölderlin, Philippe Schoeller se rapproche un peu plus de l’opéra. La rigueur formelle ni la longueur de l’œuvre (trois quarts d’heure) ne sont jamais encombrantes. Le compositeur construit véritablement un espace sonore sur le jeu du quatuor (l’impeccable Quatuor Arditti) que vient habiter de la voix et du corps la soprano Barbara Hannigan. Le nouveau système de spatialisation développé à l’Ircam (la WFS) n’est pas ici un joujou électronique mais bien un instrument au service de l’expression musicale.
Finalement, c’est une œuvre formellement assez classique, proche de la symphonie, qui est l’autre bonne surprise d’Agora 2009. Les Cuatro Escenas negras (photo) d’Alberto Posadas (né en 1951) ne connaissent en quarante minutes aucun moment de faiblesse, ce qui en dit long également sur la qualité du travail de l’ensemble L’Itinéraire dirigé par Mark Foster. La partie acoustique, parfois assez crue voire naïve, est toujours portée par sa nécessité musicale : le premier interlude est ainsi une libération après l’exceptionnelle tension entretenue à la fin du premier mouvement. Jamais strictement illustrative des tableaux de Goya dont elle s’inspire, la musique en recrée cependant l’univers. Pour ne rien gâcher, le travail du vidéaste Carlos Franklin qui accompagnait l’œuvre, empreint d’une polysémie toute musicale, marquait enfin la réussite d’un projet multimédia convaincant.
Jean-Guillaume Lebrun
Paris, du 9 au 19 juin 2009
> Lire les autres articles de Jean-Guillaume Lebrun
Photo : DR
Derniers articles
-
26 Avril 2025Jacqueline THUILLEUX
-
24 Avril 2025Michel ROUBINET
-
23 Avril 2025Alain COCHARD







