Journal
Compte-rendu : Sesto gagnant. Paris découvre La Clemenza di Tito selon les Herrmann.
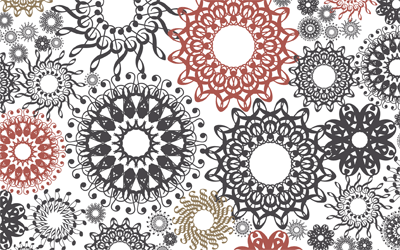
L’Opéra de Paris est chanceux avec ses Clemenza. En 1997 le sobre spectacle de Willy Decker gravait le testament musical de Mozart dans le marbre. Son travail parfait dérivait d’une mise en scène révolutionnaire, par l’intensité de la direction d’acteur, la nudité des décors, les clefs poétiques d’une lecture qui souligne que même le pardon ne pardonne pas : celle pensée par les Herrmann pour la Monnaie de Bruxelles, où Gérard Mortier imprimait alors son style et ses répertoires.
Mortier ayant investit Paris, il était logique que le spectacle emblématique de ses années bruxelloises y soit enfin présenté. Mais il ne faudrait pas que cette production historique, dans le bon sens de l’expression, nous prive du retour souhaitable de celle de Decker : les français aiment l’alternance et souhaitent la cohabitation même au sein de leurs théâtres lyriques. Au pupitre on retrouvait Sylvain Cambreling, vingt trois après Bruxelles. Il aime cette partition, la dirige moderne mais en refusant la raideur que tant de chefs croient de mise, confondant seria et austérité.
Mozart n’a jamais écrit aussi serré, aussi lunaire en même temps, son orchestre est confiné dans les tessitures médianes, empli d’obligato de clarinette, de cor ; il fonctionne tel un miroir inversé en regard de celui de la Zauberflöte à peu de chose près contemporaine : il écrivait la première de la main gauche, la seconde de la main droite. Seuls les génies possèdent le secret de cette faculté du dédoublement dans la création. Ce que Cambreling n’oublie jamais, c’est l’impact dramatique, malgré une distribution bien moins flamboyante que celle immortalisée par le disque à Bruxelles : Eda-Pierre, Nafé, Burrowes dans l’un des rôles clefs de son répertoire (seul Langridge l’y a dépassé et pour tout dire anéanti), l’Annio d’Evangelatos. On ne pourrait comparer le soprano assez neutre de Catherine Naglestadt, qui peine dès qu’une vocalise vient courber la portée, à la torche vivante, toute enflammée par les arcanes du premier bel canto, que fut Eda-Pierre. Les Vitelia sont rares, et hors notre héroïne nationale, seules Moser, Varady et Lucia Popp (dont ce fut le dernier défis) possédèrent la flamme pour incarner ce caractère et la technique pour en défaire les difficultés (dans un registre plus médian, Janet Baker sut aussi tirer son épingle du jeu). On nous promet cette belle actrice en Salomé à Bastille pour la saison 2006/2007. Gageons qu’elle y sera mieux employée.
Prégardien n’est en rien un Titus, les récitatifs sont métronomiques, sans caractères ( un comble pour l’Evangéliste de sa génération), la voix, incapable de la moindre projection héroïque, ne possède pas assez de couleurs pour faire transparaître les atermoiements psychologiques de l’empereur, le cantabile lui manque cruellement, ce que vient encore souligner une diction exemplaire mais vide d’émotion. Jolie Servilia, trop légère, d’Ekaterina Siurina, une Barberine au mieux, les années passant peut-être une Suzanne de petit rayon. Qu’est-il arrivé en cours de route à l’Annio tout feu tout flamme d’Hannah Ester Minutillo, pour que son air crucial du II soit à ce point détimbré ? Dommage, car l’actrice est formidable, la seule avec Naglestad, qui comme toute américaine connaît ses pouvoirs scéniques, à pouvoir confronter une présence face au Sesto de Suzanne Graham, figure vivante, brûlante, de l’indécision et du remord, portrait psychologique parfait de Mozart lui-même. A chaque note on aurait voulu lui envoyer une rose. Pour elle, courrez à cette Clemenza, elle vous enjolivera tout le reste, même le terrible Publio de Roland Bracht, un modèle dans son genre.
Jean-Charles Hoffelé
La Clemenza di Tito, Opéra de Paris, Palais Garnier, le 29 mai, puis les 1er, 4, 6, 9 et 12 juin.
Photo : DR Opéra de Paris.
Derniers articles
-
05 Avril 2025Laurent BURY
-
04 Avril 2025Michel EGEA
-
31 Mars 2025Laurent BURY







