Journal
Interview de la soprano Eva-Maria Westbroek
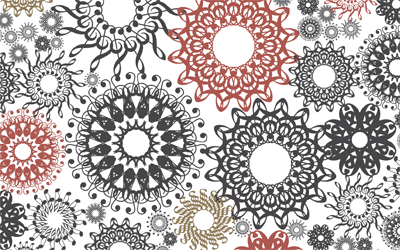
Elle est assurément la révélation vocale de ces dernières années. Voix sculpturale de spinto, présence magnétique, Eva-Maria Westbroek triomphe actuellement dans La Femme sans ombre de Strauss sur la scène de la Bastille, où elle interprète pour la première fois une Impératrice qui frise la perfection. Rencontre.
Remarquée dans les Dialogues des Carmélites en 2004, Paris a salué votre Chrysothémis (Elektra) en 2005, avant de vous retrouver cette saison dans Tannhäuser et dans Die Frau ohne Schatten à la Bastille. Qu’est-ce que Paris représente dans une carrière internationale comme la vôtre ?
Eva-Maria Westbroek : Paris demeure une place très importante dans la carrière d’un artiste. Gérard Mortier est le premier directeur de cette envergure, à m'avoir invitée dans un théâtre aussi prestigieux. J'étais en Allemagne à l'époque et j’ai reçu cette proposition avec beaucoup d’enthousiasme. J'aime beaucoup Paris, une ville étonnante qui m'a toujours attirée. M. Mortier, comme l’ensemble de son équipe, est très sympathique et il règne dans ces deux théâtres une atmosphère formidable. C’est un plaisir de travailler dans ces conditions avec de tels professionnels.
A la différence de certaines cantatrices vous n’avez pas connu de débuts fulgurants. Etudes au Conservatoire de La Haye débuts au Festival d’Aldeburgh en 1994, suivis par quelques engagements avant d’intégrer pendant cinq ans, la troupe de l’Opéra de Stuttgart. Avec le recul cette évolution progressive n’a-t-elle pas été préférable à la précipitation ?
E.M.W. : Cela dépend des personnalités et des caractères de chacun. Rétrospectivement, je n’ai pas trop à me plaindre. Une voix comme la mienne, plus dramatique, plus imposante que les autres, faisait peur et suscitait la crainte ou l’interrogation quand j’étais étudiante. J'ai heureusement pu faire mes premières armes en interprétant à plusieurs reprises Gutrune, qui n'est pas un grand rôle, mais qui m'a permis d'être sur scène, d'apprendre et de travailler avec de grands chefs. Cette expérience s’est avérée profitable. Certains démarrent leur carrière très vite, tant mieux, mais il faut de tout pour faire un monde.
Vous avez souvent évoqué les difficultés rencontrées avec vos professeurs, certains vous forçant à travailler uniquement des lieder de Brahms, au point de vous les faire détester. Quand avez-vous pris conscience que vous aviez rencontré le bon ?
E.M.W. : Tout de suite. J'ai fait la connaissance d’un ancien “heldentenor”, qui m'a comprise sans hésiter. Je chantais le plus doucement possible, sans ouvrir la voix et lui m'a demandé de faire du son et de laisser mon instrument s’épanouir. Ce fut un grand bonheur, une sorte de révélation. Il a su d'emblée ce que j'allais pouvoir chanter et tout ce qu’il a prédit s’est réalisé. Avant lui on ne cessait de me répéter qu’il fallait être patiente, prudente, sans aucune ambition, si ce n’est d’espérer intégrer un choeur. Les Hollandais ne sont pas mauvais, mais ils sont comme cela, calvinistes. Mon premier professeur, une diva bulgare, formidable, m'a fait écouter beaucoup de disques, surtout ceux de Renata Tebaldi, qui m’ont fait rêver. Mais une fois au Conservatoire, on a freiné mes ardeurs en me conseillant de revenir à la réalité. Pourtant à 16 ans je possédais cette voix de spinto, faite pour Tosca, Andrea Chénier et Elisabeth de Tannhäuser. Aujourd'hui en Hollande on est très fier de ma réussite et tout le monde est très gentil.
Vous avez raconté avoir vécu des années de galère avant que le vent ne se mette à tourner. Etes-vous aujourd’hui en mesure de diagnostiquer ce qui vous a manqué entre 1994 et 1999 ?
E.M.W. : La joie. J'ai perdu ma mère en 1994 et cela a été un choc. Ma vie a changé brutalement et je me suis retrouvée dans une profonde déprime. Rien n’allait comme je le souhaitais, je me sentais mal dans ma peau et il est impossible de chanter correctement quand on est triste ; la gorge se rétrécit, tout se coince et personne ne vous fait confiance. J’étais au désespoir jusqu’au jour où j'ai commencé une thérapie, par l’hypnose, qui m’a transformée. Je suis redevenue une autre personne et tout à coup j'ai réussi tout ce que j'entreprenais. J'ai passé une audition pour chanter au Komische Oper de Berlin et j’ai été engagée pour Don Carlos, ma première Elisabetta : je n'y croyais pas. Puis ce fut Chrysothémis à l’Opéra de Berlin et l’engagement à Stuggart, où l’on m’a confié d’abord Gutrune, puis Die Gezeichneten, Donna Anna, La Fiancée vendue et Tosca, que j’avais chantée à Rome quelques années auparavant.
Sieglinde à Aix l’été dernier, Tannhäuser puis votre première Impératrice à Paris, vous voici dans la cour des grandes, dans des œuvres gratifiantes sur le plan vocal et dramatique. Ceux qui vous ont vue sur scène connaissent votre plaisir de jouer et d’occuper l’espace. Comment vous êtes-vous adaptée à l’esthétique épurée et millimètrée de Bob Wilson, metteur en scène de cette Frau onhe Schatten ?
E.M.W. : Cela n’a pas été facile, mais cette expérience s’est révélée formidable. Bob Wilson nous a expliqué que son but était de focaliser l'attention du spectateur sur certains points, ce qui demande une concentration extrême. J’ai travaillé des heures avec ses assistants sur la position exacte des mains sous la lumière, ce qui m’a aidé. C'est très fatiguant et je sors des représentations épuisée, mais satisfaite.
Comme avant vous Léonie Rysanek, Birgit Nilsson, Gwyneth Jones, Hildegard Behrens et aujourd’hui Nina Stemme ou Karita Mattila, dont vous êtes artistiquement proche, il semble que vous recherchiez un équilibre entre le répertoire germanique et l’opéra italien qui vous passionne. Quels risques feriez-vous subir à votre instrument si vous privilégiez davantage l’un par rapport à l’autre ?
E.M.W. : Personnellement l'opéra italien m’est indispensable, car il demande une technique très particulière, notamment chez Verdi, qui nécessite plus de contrôle et conduit à chanter d’une manière différente. Si je ne m’y confronte pas régulièrement, j’ai l’impression de perdre le legato et de ne plus contrôler aussi nettement la ligne de chant. Je ne sais pas pourquoi mais je chauffe toujours ma voix avec des airs italiens, comme si cela allait de soi. De nos jours les cantatrices sont classées entre celles qui chantent le répertoire allemand et celles auxquelles le répertoire italien est réservé. J'ai eu beaucoup de difficultés à m’imposer dans les oeuvres italiennes, car je suis grande et blonde, donc vouée aux héroïnes wagnériennes. Stemme est une Aïda magnifique, Mattila une Manon Lescaut amirable et je m'en réjouis. Ne chanter que l'allemand ne serait pas sain pour mon instrument.
La scène, à la différence de la vie permet d’être à l’infini quelqu’un d’autre : où puisez vous l’inspiration pour nourrir les personnages que vous devez incarner ?
E.M.W. : J'adore le cinéma de toutes et en particulier les films de Pedro Almodovar. Je me souviens avoir cherché comment pousser le cri de Gutrune après la mort de Siegfried dans Götterdämmerung ; je voulais quelque chose de désespéré que je ne trouvais pas dans les enregistrements, jusqu’au jour où j'ai entendu le cri de Glenn Close à la fin des “Liaisons dangereuses” de Stephen Frears, au moment où elle se retrouve trahie, rejetée. Elle m’a fascinée et je m'en suis inspirée. Observer les gens dans la rue est également très riche d’enseignements.
Sur votre planning se profilent Verdi (La Forza del destino), Wagner, Puccini (La Fanciulla del West), Lehar (Die lustige Witwe) et même Catalani (La Wally). Avec une prononciation du français telle que la vôtre, ne pensez-vous pas aborder un jour Iphigénie en Tauride et Alceste de Gluck, ou encore Les Troyens de Berlioz ?
E.M.W. : J'ai toujours des idées, mais encore faut-il qu’elles puissent se concrétiser (rires). J'adore chanter en français, alors que cette langue est réputée difficile. J'aimerai beaucoup aborder les oeuvres de Gluck qui conviendraient à mon type de voix. J'ai un projet en cours avec Les Troyens, mais pour le moment je ne peux pas vous en dire plus.
Malgré la fin annoncée de l’industrie discographique, les difficultés financières de certaines salles, les grèves, l’opéra continue d’exister et de faire rêver les foules. La concurrence entre cantatrices appartenant à la même génération et de gabarit similaire est-elle grande de nos jours ?
E.M.W. : Je ne la ressens pas du tout, mais cela est très personnel. En ce moment avec La Femme sans ombre, je suis heureuse de pouvoir chanter en compagnie d’artistes comme Christine Brewer que j'admire énormément : sa voix est une source d’inspiration. J'adore être en contact avec des interprètes qui chantent bien et qui communiquent leur passion ; c'est stimulant. J'ai eu la chance d'entendre Adrienne Pieczonka dans Sieglinde et dans l’Elisabetta de Don Carlos où elle était magnifique. Vous savez, on ne peut pas être partout dans les mêmes théâtres et au même moment. Je crois sincèrement qu’il y a de la place pour tout le monde, ce qui est rassurant.
En qui avez-vous le plus confiance artistiquement?
E.M.W. : Mon mari, qui est ténor. Vocalement nous avons les mêmes goûts. Il est très strict, ses critiques sont souvent sévères, mais j'ai une entière confiance en lui. Ses oreilles sont redoutables et il sait apporter les réponses aux questions techniques que je peux me poser. J'avoue que j’ai beaucoup de chance.
Quels sont les grands théâtres où vous n’avez pas encore été invitée et où vous rêvez de chanter ?
E.M.W. : Sans hésiter, celui de Manaus, au Brésil ; j'aimerai énormément chanter dans la jungle et y emmener toute ma famille pour passer des vacances. Il y a également le Teatro Colon de Buenos Aires et celui de Santiago du Chili. J'aime beaucoup le tango ; je me souviens être allée au Chili il y a longtemps avec un ami, un pays qui m'a laissé de grands souvenirs.
Propos recueillis par François Lesueur
Photo : DR
Derniers articles
-
17 Décembre 2025Jean-Guillaume LEBRUN
-
17 Décembre 2025Laurent BURY
-
16 Décembre 2025Alain COCHARD







