Journal
L’inaltérable jeunesse de West Side Story
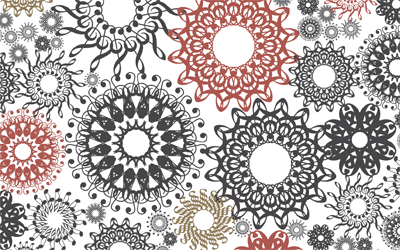
Il faut s’y faire, le Théâtre du Châtelet a décidé d’être là où l’on ne l’attend pas. Après Bintou Wéré, première œuvre lyrique africaine au sujet ouvertement politique et social, et avant Véronique, l’opérette d’André Messager, on y célèbre le demi-siècle de West Side Story, l’une des comédies musicales les plus abouties du répertoire américain, sortie de l’imagination d’un trio inégalé : Leonard Bernstein (musique), Stephen Sondheim (paroles) et Jerome Robbins (chorégraphie).
Immortalisé à l’écran par Robert Wise en 1961, dont le film flamboyant fit beaucoup pour démultiplier et prolonger sa notoriété, ce musical remporta un succès considérable à sa création, le 26 septembre 1957, sur la scène du Winter Garden Theatre de New York. C’est cette version fidèle à l’originale, réglée par Joey McKneely d’après la mise en scène et la chorégraphie de Jerome Robbins (décédé en 1998), que la Châtelet a choisi d’accueillir pour une cinquantaine de représentations.
Comme toujours avec les troupes américaines merveilleusement préparées et rôdées, on admire la précision, l’énergie et le professionnalisme qu’elles dégagent. Inutile de chercher la moindre défaillance, le plus infime accroc, tout est en place, rien ne dépasse, chacun jouant sa partition au millimètre avec un souci de perfection et une acuité vertigineuse.
Les jeunes artistes réunis pour faire revivre cette terrible histoire – inspirée de Roméo et Juliette – de rivalités entre bandes ennemies dans le New York profond des années cinquante, s’avèrent d’incontestables danseurs, aguerris et virtuoses dans les grands ensembles (Mambo, Cha-cha, America, Scherzo du ballet) que le public parisien savoure avec gourmandise. Ils se montrent en revanche de piètres comédiens dès qu’il s’agit de donner vie aux scènes parlées, qui ralentissent le rythme et prêtent parfois à sourire. Malgré une formation réputée pour sa solidité et son exhaustivité, ces interprètes encore peu chevronnés musicalement, peinent également à se glisser dans les tessitures inconfortables inventées par Bernstein et à en restituer l’expressivité particulière.
Plus exposés que les autres, les rôles principaux ne sont pas irréprochables. Sean Attebury est un Tony avenant, qui sait tirer profit de son physique un peu frêle pour exhaler une certaine fragilité. Celle-ci rend touchant le célèbre « Maria », mais la voix demeure légère et passe-partout, malgré la très forte amplification. Ann Mac Cormack, elle aussi exagérément amplifiée, ce qui accentue la rigidité de son timbre, manie assez sèchement le registre de l’émotion, ce qui a pour conséquence de figer sa Maria (« I have a love »), que l’on attend plus séduisante et chaleureuse. Vivian Nixon prête pour sa part à Anita un corps de rêve (la danseuse est splendide), mais on regrette ses accents outrés dans « A boy like that ». Spencer Howard (Riff) et Gabriel Canett (Bernardo) eux aussi, excellent davantage pour la partie dansée que pour la partie chantée.
L’orchestre dirigé par Donald Chan n’est pas toujours d’une rigueur absolue (Prologue), certaines inventions mélodiques et certains traits rythmiques échappant à sa vigilance, mais la partition sonne avec éclat et, même cinquantenaire, surprend encore par son audace et son inaltérable jeunesse.
Prochaines étapes après Paris, Zürich, Leipzig et Baden-Baden.
François Lesueur
Théâtre du Châtelet, 21 novembre 2007 / Jusqu’au 1er janvier 2008
Photo : Concertclassic.com
Derniers articles
-
28 Avril 2025Alain COCHARD
-
28 Avril 2025Michel EGEA
-
28 Avril 2025Alain COCHARD







