Journal
Dossier Mahler / IV - A la source des mots
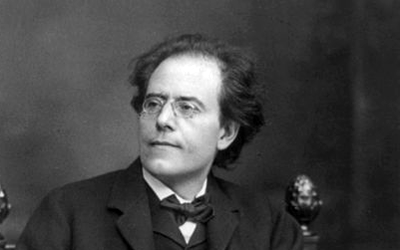
Chez Mahler aussi, l’arbre cache la forêt. Ce symphoniste qui aura épuisé le langage de l’orchestre, ce novateur tranquille qui aura montré à la Seconde Ecole de Vienne son chemin tient secret derrière le rempart de ses dix Symphonies la source réelle de son art : la poésie.
Si l’on y songe vraiment, la pensée musicale si particulière de Mahler s’est toujours appuyée sur des textes. C’est même ce rapport au texte, et plus encore à la parole, qui est à la source de son style musical si particulier, et même des ambitions de révision formelle qu’il mettra en œuvre.
Mahler est si conscient de l’importance et des tendance hégémoniques de ce que l’on ne peut désigner autrement que sous le terme de sous-texte, qu’il lui a très tôt opposé un contrepoint efficace en truffant sa musique de motifs signalétiques qui empruntent à des genres exogènes au domaine classique : sonneries militaires, imitations naturalistes, éléments caractéristiques de musique de danse rurale, toujours des réemplois brefs mais récurrents qui fuient le développement.
Sa veine lyrique si caractéristique – Mahler, comme Purcell, Mozart et Schubert est un pur génie de la mélodie – le pousse à écrire des dessins mélodiques aspirant souvent à l’ infini comme le grand thème central du finale de la Symphonie n°1 ou celui suspendu à dessin de l’Adagietto de la 5ème Symphonie. Hors le galbe des mélodies de Mahler est toujours modelé sur la parole humaine. Dans ce domaine, seul Janacek aura été plus loin, transmuant la plus infime tentation de mélodie en parole, asséchant la musique par le mot, faisant en quelque sorte le chemin inverse de celui pratiqué par Mahler qui, lui, gorgeait ses thèmes de vocalité.
Plus étonnant encore apparaît son premier cycle de mélodies clairement envisagé comme un hommage aux itinéraires schubertiens, ces Lieder eines fahrenden Gesellen (Chants d’un compagnon errant) qui sont un autoportrait psychologique de l’auteur ayant revêtu l’habit du voyageur. Cycle initiatique, d’une puissance suggestive rare, où Mahler met en œuvre l’essentiel des thèmes qu’il réemploiera dans la version définitive de sa Symphonie n°1 «Titan». En quelque sorte il se pose ici au centre névralgique de sa fascination pour un abondant recueil poétique qui va décider de l’évolution de son art, le Knaben Wunderhorn (1891).
Dès l’époque de la 1ère Symphonie (1884-1896) Mahler avait préalablement forgé son langage musical en écrivant au cour des années 80 non seulement une grande brassée de lieder où il employait déjà des poèmes du Knaben Wunderhorn, mais également une partition novatrice qui résonne encore comme un manifeste de la nouvelle musique d’alors, Das Klagende Lied (littéralement Le chant plaintif).
Mahler y utilise en des termes tout personnels le récitatif wagnérien idéalement appariés à ce sujet médiéval revu et corrigé par l’esprit de la fin du XIXe siècle, il y produit également un langage très personnel, où le chant est plus d’une fois comme débordé par les sources populaires bohémiennes. C’est toute l’enfance morave de Mahler qui constitue la toile de fonds de la cantate, non seulement pour les couleurs et la poétique orchestrale, mais également pour les tournures vocales qui se réfèrent sans cesse aux chansons tchèques, au point d’ailleurs que l’œuvre apparaît si on la considère avec un certain recul, comme une vaste ballade de Minnesänger. La parole est au centre même du Klagende Lied, parole tour à tour démonstrative, proche de la scène lyrique, ou pliée dans les formes canoniques du chant populaire.
Ce premier coup de boutoir, avec ses imperfections et ses traits de génie, allait ouvrir la voie à un envahisseur qui régnera sans partage sur la création mahlérienne jusqu’en 1901, année qui verra le compositeur revenir au seul orchestre avec la 5e Symphonie : ce fameux Knaben Wunderhorn.
De 1805 à 1808, Clemens Brentano et Achim von Arnim réunirent en trois forts volumes un ensemble de plus de mille poèmes de la tradition populaire, herborisés par les auteurs des rives du Neckar à celles de l’Elbe, le portrait vivant de la vérité littéraire du peuple allemand. Les deux poètes suivirent en cela l’exemple de Goethe et Herder, eux même lancés en leur temps dans un passionnant voyage au cœur de la poésie populaire allemande. Le Knaben Wunderhorn (Le cor enchanté de l’enfant), outre qu’il contenait nombre de trésors que Brentano s’employa à polir sans en gommer le caractère parfois abrupt, correspondait par son esprit naïf, son ton souvent ironique – deux éléments qui peuvent sembler antithétiques, qui le sont en effet, mais qui opèrent une synthèse singulière tout au long des trois tomes – aux aspirations de Gustav Mahler qui, depuis le Klagende Lied, recherchait un corpus de textes libérés de la pesanteur rhétorique qui encombrait une grande part de la poésie romantique germanique.
Les poèmes du Knaben Wunderhorn, mais plus encore l’esprit du recueil tel que l’accentuèrent Arnim et Brentano, ce savant méli-mélo de naïveté et de raffinement, de simplicité apparente et d’arrière-plans d’une densité psychologique certaine, constituèrent pour Mahler le fil rouge de l’inspiration de ses trois symphonies vocales (la 2e «Résurrection», la 3e et la 4e), participant au premier chef à l’éclatement de la forme classique en quatre mouvements, et dictant le renouvellement même du genre : des symphonies, peut-être accessoirement, des poèmes épiques (2e ), narratif à tendance descriptive (3e), ou uniment lyrique (4e) bien plutôt.
C’est donc par la source littéraire, en quelque sorte en lui obéissant, que Mahler a forgé à la symphonie un nouveau destin, lui a permis de conquérir de nouveaux territoires tout au long du XXe Siècle. Il n’y a qu’à penser à la 3e Symphonie de Szymanowski, à la 3e de Gorecki, aux symphonies vocales de Chostakovitch, pour ne pas évoquer la Sinfonia de Berio où Mahler et sa 2e Symphonie tiennent la première place au centre d’un musée de citations étourdissants.
Lorsqu’en 1901 Mahler voulut à nouveau se mesurer au seul orchestre en entreprenant consciemment d’écrire une trilogie symphonique radicale que constitueront les Symphonies nos 5, 6 et 7, il tourna le dos au Knaben Wundehorn, en ayant en quelque sorte épuisé l’esprit. Mais il ne pouvait renoncer au fil rouge du lied, et il retrouva l’esprit du cycle abandonné depuis les Lieder eines Fahrenden Gesellen.
Le temps des lieder d’après Rückert était venu. Mahler vouait une fascination un rien morbide à l’imposant recueil – 428 poèmes - que Friedrich Rückert avait écrit sous le coup de la disparition successive de ses deux enfants, Luise et Ernst, emportés par la scarlatine. Mahler allait choisir cinq poèmes et les réunir en un cycle hélas prémonitoire en conservant le titre du recueil de Rückert, Kindertotenlieder (que l’on traduit approximativement par Chants pour les enfants morts, mais qu’il faudrait transcrire plus littéralement par Chants des enfants morts).
Ici, Mahler atteint à un degré supplémentaire dans la fusion de la musique au sein de la poésie. Les rythmes sont calqués sur la prosodie et seules des libertés très surveillées sont prises avec le chant syllabique : le compositeur perfectionne son idéal du chant parlé qui doit assurer un impact émotionnel immédiat, ce à quoi les Kindertotenlieder parviennent effectivement.
Cette attention fanatique au mot audible en musique à certainement beaucoup compté dans la préférence accordée par Mahler aux voix médianes, qui sont plus naturellement placées dans le registre de la voix parlée que celles des tessitures extrêmes. On sait que les sopranos ou les basses ont tendance à modifier les couleurs des voyelles. Et Mahler privilégia plus précisément encore la voix de baryton - en sollicitant plutôt l’aigu dans les Lieder eines fahrenden Gesellen, plutôt le grave dans les Kindertotenlieder - voix plus sèche en harmonique, plus proche naturellement des phonèmes.
Si dans les Kindertotenlieder Mahler ouvre plus encore à l’auditeur les portes de sa sphère privée, il ne pouvait pourtant pas se douter qu’il se trouverait confronté au sujet même de son œuvre : durant l’été 1907, il devait perdre sa fille chérie, Maria, qui souffrit le martyre comme les enfants de Rückert soixante-dix ans plus tôt, emportée elle aussi par la scarlatine. Parallèlement à la couleur dramatique qui enveloppe les Kindertotenlieder, Mahler tira d’autres poèmes un second cycle lui aussi constitué de cinq lied, les Rückert-Lieder où il recherche l’apaisement à travers tout à la fois une sublimation et un dédain du monde. Ensemble parfait qui d’ailleurs ne fut jamais absolument pensé comme tel mais bien plus simplement assemblé dans une même vêture d’orchestre.
Après les prospectives radicales réalisées au long de la trilogie des symphonies instrumentales, Mahler allait s’immerger une dernière fois dans la musique vocale, produisant à deux ans de distance d’une part une de ses œuvres les moins abouties, voir par bien des aspects les plus fragiles, et d’autre part le premier de ses trois ultimes chefs d’œuvre. Avec la 8e Symphonie, Mahler entreprenait durant l’été 1906 d’écrire sa profession de foi envers son art. L’œuvre passe pour colossale par le nombre de ses exécutants – même si on peut la donner avec certes un effectif orchestral imposant mais avec un chœur raisonnable : mille exécutants, c’est bien six-cent de trop pour le moins.
Mais ce colosse a décidément des pieds d’argile et reste une œuvre indécise : chacune de ses parties, le Veni Creator, puis la scène finale du Second Faust de Goethe pourraient se suffirent à elles mêmes, entités qui se considèrent d’ailleurs à peine et se succèdent sans se questionner ni plus se répondre.
Symptomatiquement, tout le génie si personnel que Mahler avait employé dans ses opus vocaux est ici comme absent – sinon dans le chant de l’Egyptienne – remplacé par un style vocal formel aussi bien pour les solistes que pour les chœurs. Et si l’on compare la seconde partie de la partition avec les Scènes de Faust de Schumann, on sait immédiatement où se trouve le chef-d’œuvre. La Huitième Symphonie voulait délivrer un message, mais on l’entend pour ainsi dire muette jusque dans ses plus vastes et solaires déploiements comme dans ses errements nocturnes. Mahler craignait de se confronter à l’écueil fatal qu’avait été pour Beethoven sa 9e et ultime symphonie. Chiffre d’autant plus dangereux que Mahler se savait malade. Il se résolut donc à écrire une symphonie vocale dont le titre Das Lied von der Erde, le dédouanerait des risques de la numérotation. Pourtant, il faut vraiment considérer Le Chant de la Terre comme sa dixième symphonie (et donc la 9e comme sa 10e, et sa 10e comme de fait sa 11e).
Inspiré par le recueil « La flûte chinoise » assemblage de poésies classiques de l’Empire du Milieu traduite par Hans Bethge, Mahler composa donc une symphonie en six mouvements qui lui permit de parvenir à l’absolue transmutation poétique de la musique en parole dans son dernier volet, L’Adieu, qui dure autant que les cinq premières parties.
Ici Mahler atteint à une qualité expressive de parlando qu’on ne retrouvera plus ailleurs et que les Viennois essaieront de codifier malencontreusement en créant le sprechgesang. Impossible de décrire ce à quoi le compositeur est parvenu, il faut l’entendre pour le croire.
Après ce point de non retour, Mahler se tourna à nouveau vers l’orchestre, donnant au Chant de la terre un pendant strictement musical avec la 9e Symphonie – la moins naturellement vocale des œuvres purement orchestrales du compositeur – avant de se lancer dans l’entreprise radicale, et demeurée inachevée, de la 10e Symphonie.
Dans cette œuvre ouverte sur l’infini, la prééminence du texte reparaît, mais sous la forme d’une adresse constante à Alma Mahler, que le compositeur veut reconquérir en la soustrayant à Walter Gropius. La partition est littéralement envahie par un contre-texte qui à la fois l’exalte et l’explique. Mahler, dans son dernier opus, aura significativement été plus loin avec les mots qu’avec les notes.
Décidément, le destin savait à qui il avait à faire.
Jean-Charles Hoffelé
Photo : DR
Derniers articles
-
10 Avril 2025Vincent BOREL
-
10 Avril 2025Laurent BURY
-
08 Avril 2025Jacqueline THUILLEUX







